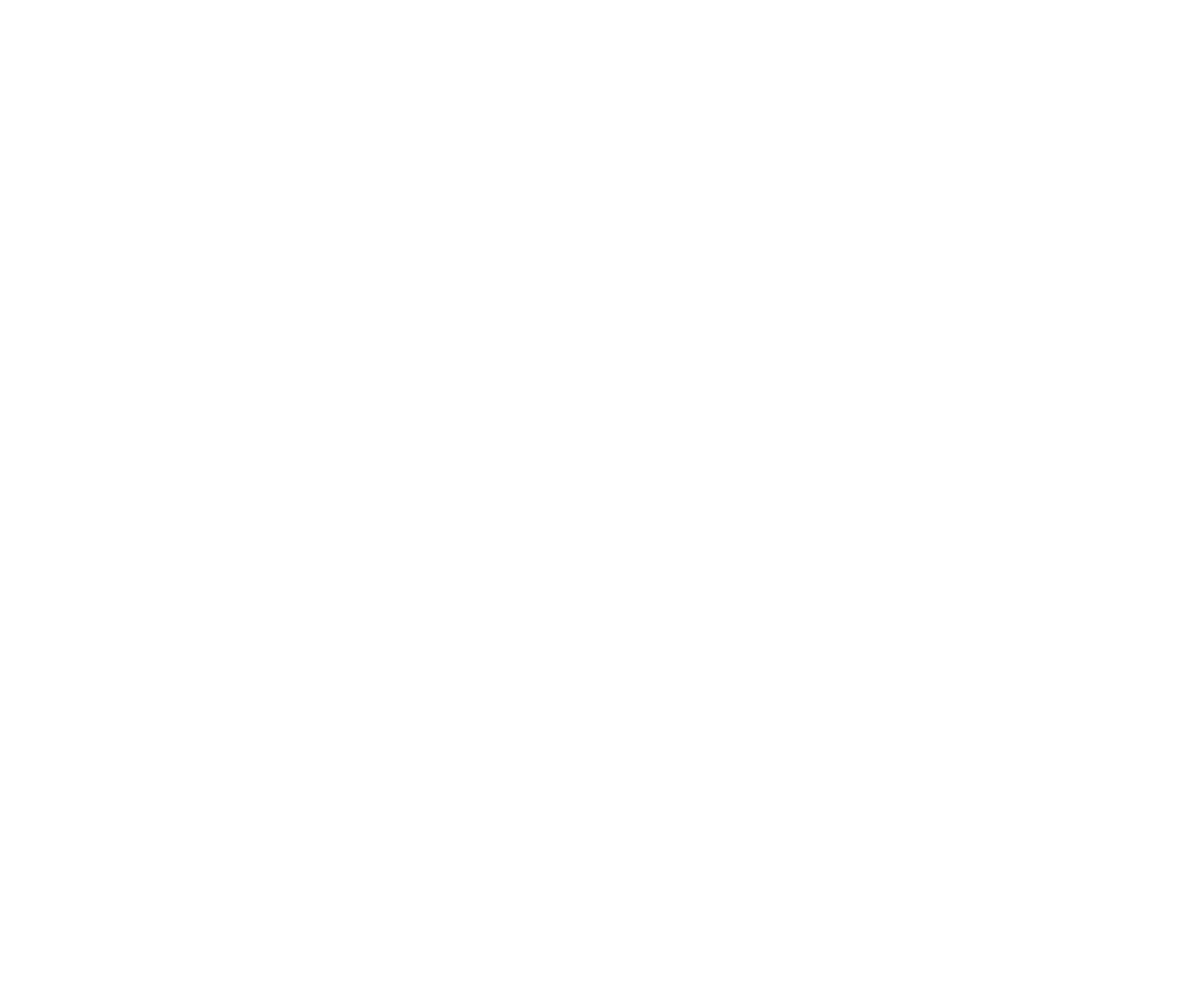“Affaire Palmade” ,, obsessions et errements médiatiques
Chiffres clés et méthodologie
- 30 heures et 50 minutes de magazines de BFM TV (talk shows et grands reportages)
- 6 contenus originaux sur bfmtv.com
- 30 articles du Parisien/Aujourd’hui en France
- 43 contenus originaux sur leparisien.fr
Chapitres

Objectiver une bulle médiatique
Près de 30 000 mentions de l’accident impliquant Pierre Palmade dans les médias, surtout audiovisuels, sur le seul mois de février 2023, c’est presque autant que sur la mobilisation contre la réforme des retraites et cela représente un quart de la couverture de l’actualité en Ukraine sur la même période.
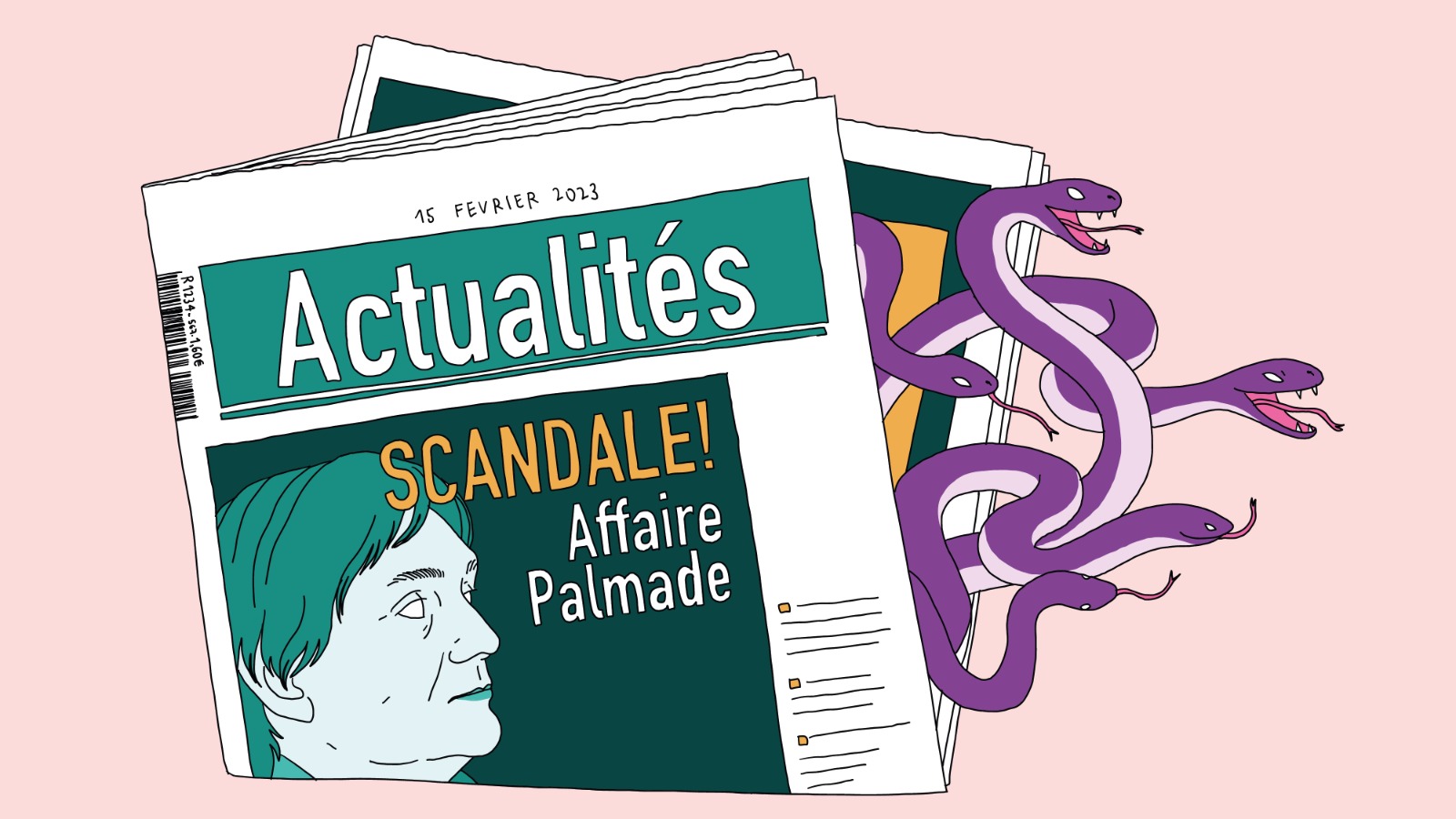
Homophobie d'atmosphère et respect de la vie privée
Dans les jours qui suivent l’accident, "Le Parisien" et BFM TV s’appuient sur les écrits et les interviews passées de Pierre Palmade pour analyser les faits et posent ainsi une grille de lecture marquée par l’homophobie intériorisée de l’humoriste. Son exposition médiatique et l’ouverture de trois enquêtes successives seront autant d’invitations à investiguer jusqu’à l’emballement et au déballage de l’intimité du comédien.

Chemsex, la boîte à fantasmes
Avec “l’affaire Palmade”, le grand public découvre le chemsex qui, par un syllogisme répété à l’envi, devient, avec la cocaïne, la cause de l’accident. Entre fascination et sensationnalisme, cet intérêt soudain ravive les stéréotypes homophobes et renforce la stigmatisation des chemsexeur·euses.

Fausses pistes, ambiguïtés et fake news
Entre sidération, injonction à la transparence et jugement moral, “l’affaire Palmade” devient un feuilleton rythmé par l’avancée des enquêtes. Quand un volet pédocriminel surgit, les invitations à la prudence ne se traduisent pas en actes.
Interviews

“Sur Pierre Palmade, la presse a mis en exergue sa consommation de drogues et porté un jugement sur ses pratiques sexuelles, quitte à caricaturer”
Couverture disproportionnée et souvent discriminatoire, phénomène de bouc émissaire… Lucile Jouvet Legrand, sociologue des médias et spécialiste des faits divers, analyse les résultats de l'étude menée par l'AJL.

“La question du chemsex a été organisée comme une panique morale”
Avec l'apparition du chemsex dans la sphère médiatique, l'accident de Pierre Palmade a durablement marqué le traitement de cette question, analyse Aurélie Olivesi, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon-I.
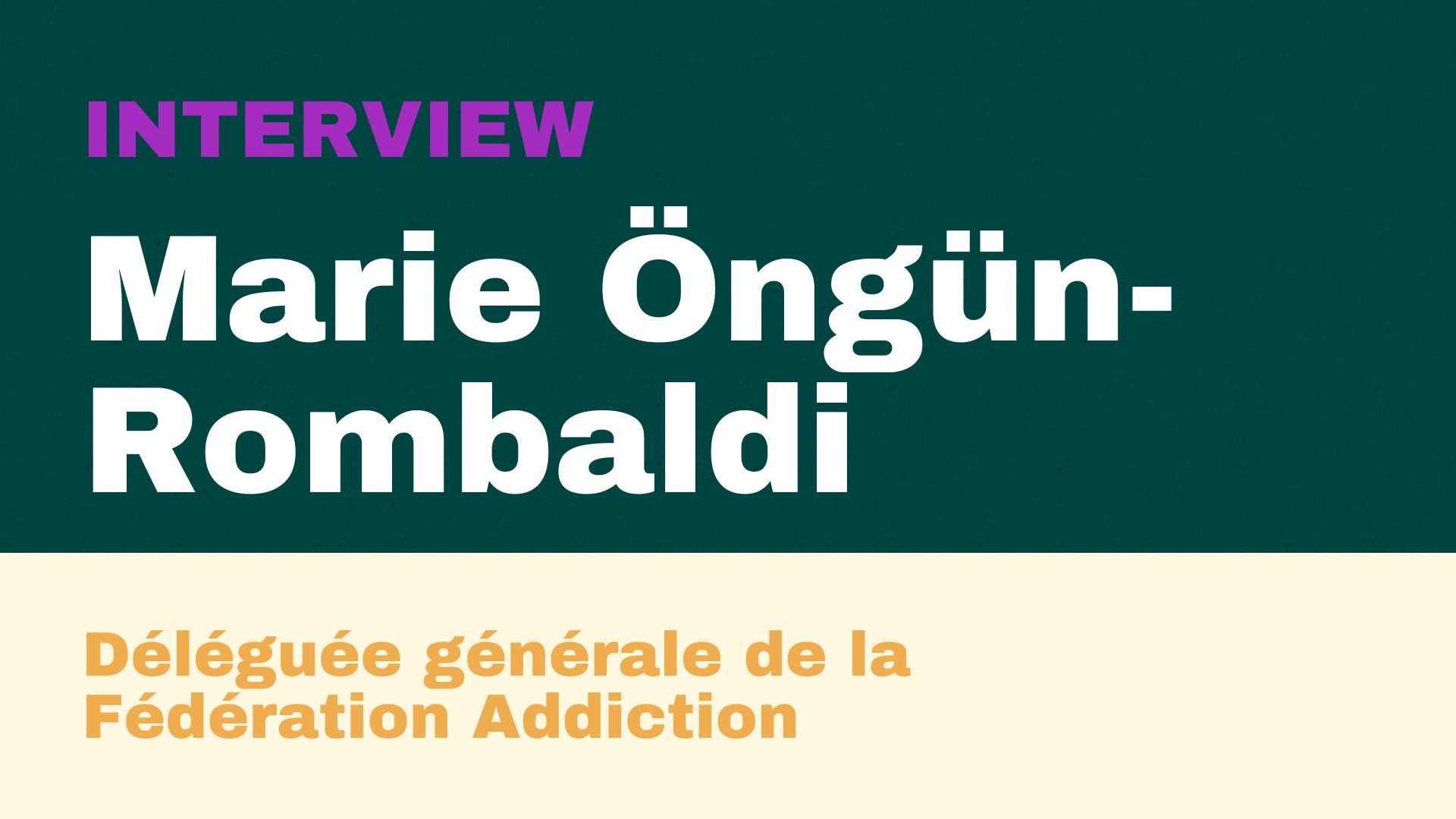
“Empreintes d’une homophobie latente, certaines rédactions stigmatisent les consommateur·ices de drogues et les pratiquant·es du chemsex”
Lors de “l’affaire Palmade”, entendre des termes comme “fléau”, “cauchemar”, “invasion” dans l’espace médiatique a renforcé la stigmatisation des consommateurs de produits psychoactifs. Entretien avec Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction, premier réseau d’addictologie en France.