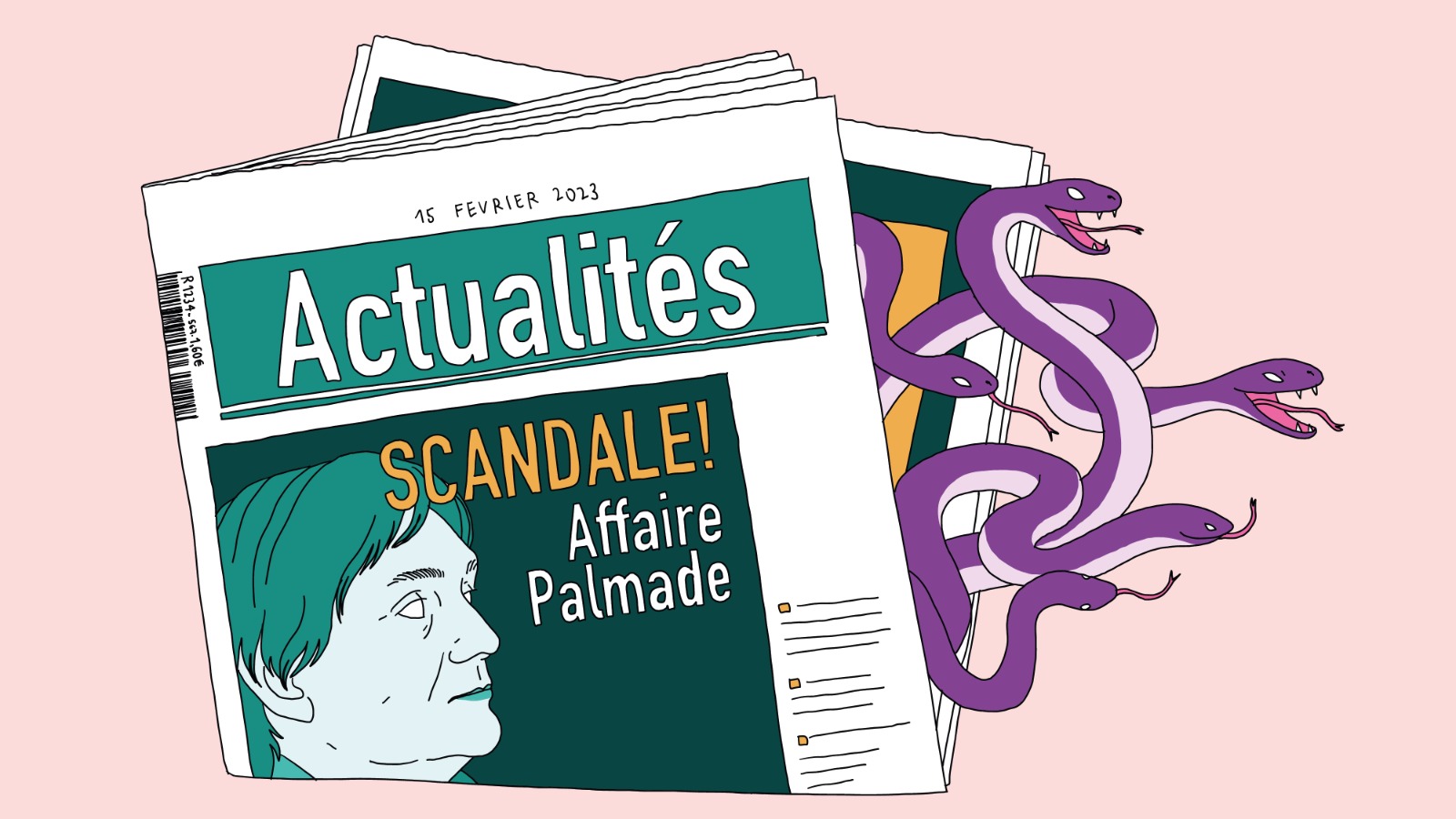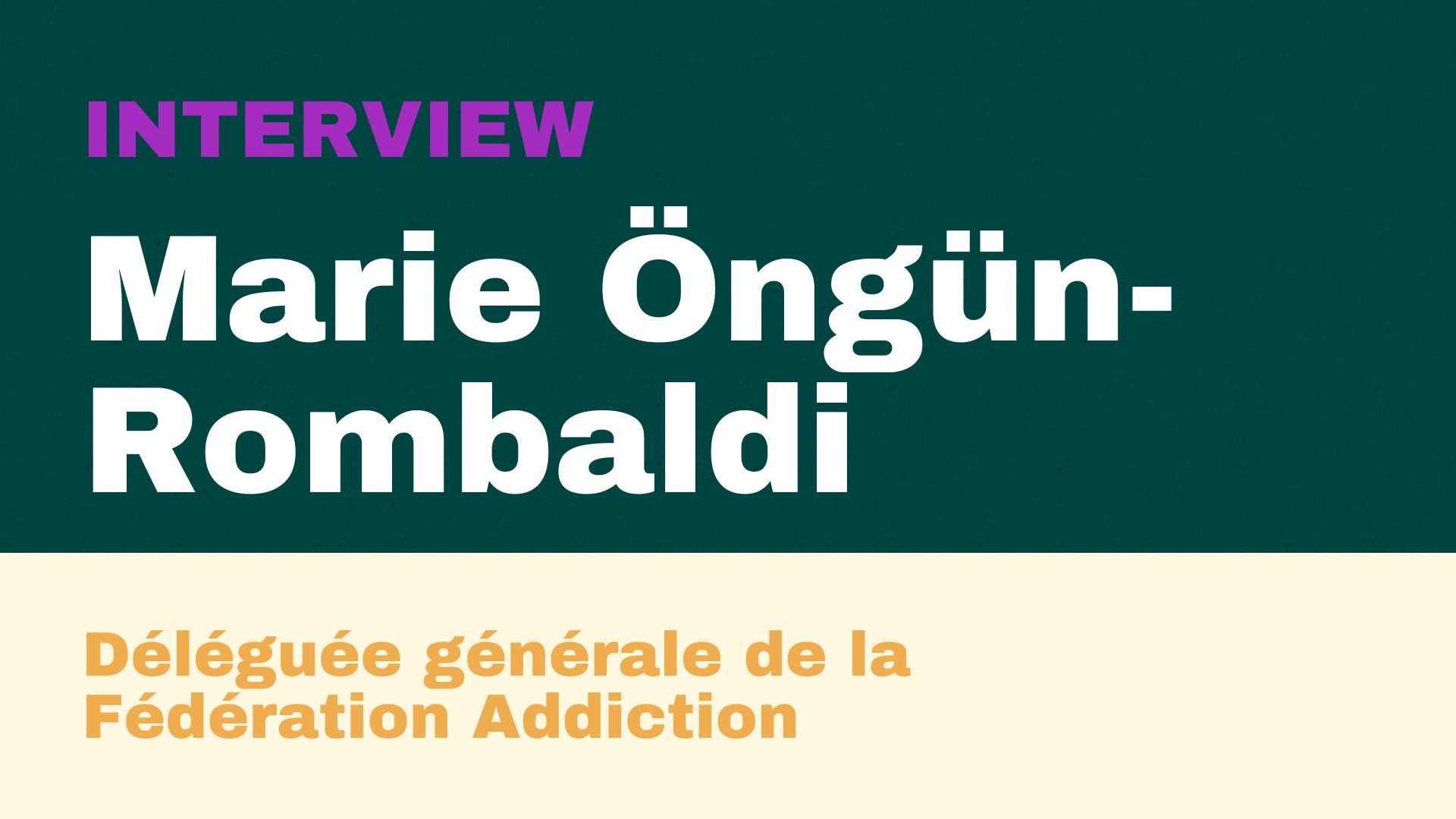Propos recueillis par Clément Giuliano
Intro : Le fait divers impliquant l’acteur a, pour la première fois dans l’histoire des médias, mis au premier plan la question de la consommation de drogues dans un cadre sexuel. Mais avec un grand nombre de discours négatifs et moralisateurs, les enjeux de santé publique et de prévention ont été absents. Pour Aurélie Olivesi, maîtresse de conférences HDR en sciences de l’information et de la communication à l’Université Lyon-I, le traitement de “l’affaire Palmade” sous l’angle du divertissement a contribué à les occulter.
Vous travaillez notamment sur le discours médiatique à travers l’expression du genre. Y a-t-il des éléments qui vous ont frappée dans le traitement de l’accident de Pierre Palmade ?
Je dirais évidemment la question du chemsex. Ce fait divers a fait surgir ce mot, qui était très peu présent – voire quasi-absent – auparavant dans le débat public. J’ai relevé dans la presse généraliste une trentaine d’occurrences avant Pierre Palmade entre 2016 et février 2023, et une cinquantaine depuis l’accident. Ces occurrences sont la plupart du temps associées à Pierre Palmade. Et malgré cette forte augmentation de son utilisation, je n’ai pas l’impression que le terme soit tellement défini par les médias.
Lorsqu’un mot apparaît dans le débat public, cela devient un prisme. En science de l’information et de la communication, on parle de « cadrage », c’est–à-dire l’ensemble des données qui vont être sélectionnées et retenues pour construire une représentation. Dans ce cas précis, le chemsex n’est pas présenté comme un problème de santé publique, mais se retrouve étiqueté comme « le truc de Pierre Palmade », ayant conduit à un accident. Traité par ce prisme, la question du chemsex me semble organisée comme une panique morale, vue sous le terme de la nuisance, de la peur, de l’exhibition… Et la question de la santé n’est plus du tout évoquée dans la presse, alors que c’était le cas dans les articles publiés auparavant.
Lorsqu’un mot apparaît dans le débat public ainsi à la faveur d’un fait divers, laisse-t-il des traces dans la représentation ? On peut notamment remarquer l’utilisation dans certains articles des termes « un Pierre Palmade » pour désigner un homme consommant des substances dans un cadre sexuel…
La linguiste Sophie Moirand a élaboré une notion qu’elle a baptisée « moment discursif ». Certains événements – des faits divers, mais pas uniquement – font surgir une grande quantité de discours négatifs. Lorsque l’événement est passé, il en reste des traces dans le discours et, en se conjuguant aux effets du cadrage, cela va influencer la façon dont on va appréhender la question. Par exemple, au moment de l’affaire DSK en 2011, les revendications des féministes sur le viol, qui était assez inaudibles jusque là, ont pu entrer dans le cadrage de la définition du viol telle qu’on peut la trouver dans les grands médias, et cela a laissé des traces que l’on a retrouvées au moment #MeToo.
Quant au fait de parler d' »un Pierre Palmade » comme un nom commun – on parle d’« antonomase« – cela est rendu possible parce qu’il y a une représentation qui s’est peu à peu enkystée. On a l’histoire en tête même si ça reste quelque chose d’assez vague – et l’antonomase permet de rester assez vague. Cela renforce encore le cadrage et accentue la vision univoque de l’affaire.
L’orientation sexuelle de Pierre Palmade a-t-elle favorisé l’emploi de termes sensationnalistes ?
C’est principalement le locuteur ou la locutrice qui joue dans cette question. Dans la presse généraliste, par exemple, les termes semblent relativement neutres, avec assez peu d’allusions. A contrario, l’accident de Pierre Palmade a fait l’objet à la télévision, d’un traitement relevant du divertissement par des personnes qui ne sont pas journalistes. Je pense notamment à Touche pas à mon poste qui avait réalisé des records d’audience quelques mois plus tôt sur un autre fait divers – l’affaire Lola1. Ce type de traitement, où l’orientation sexuelle vient se conjuguer à la question du sexe, de la drogue et de la tragédie, favorise évidemment le sensationnalisme.
- Le corps de Lola Daviet, âgée de 12 ans, est découvert le 14 octobre 2022 dans une malle à proximité de l’immeuble du 19e arrondissement de Paris où elle réside avec sa famille. La principale suspecte dans l’affaire, Dahbia Benkired, est mise en examen quelques jours plus tard. L’affaire est instrumentalisée par l’extrême droite alors que cette dernière faisait l’objet d’une OQTF.