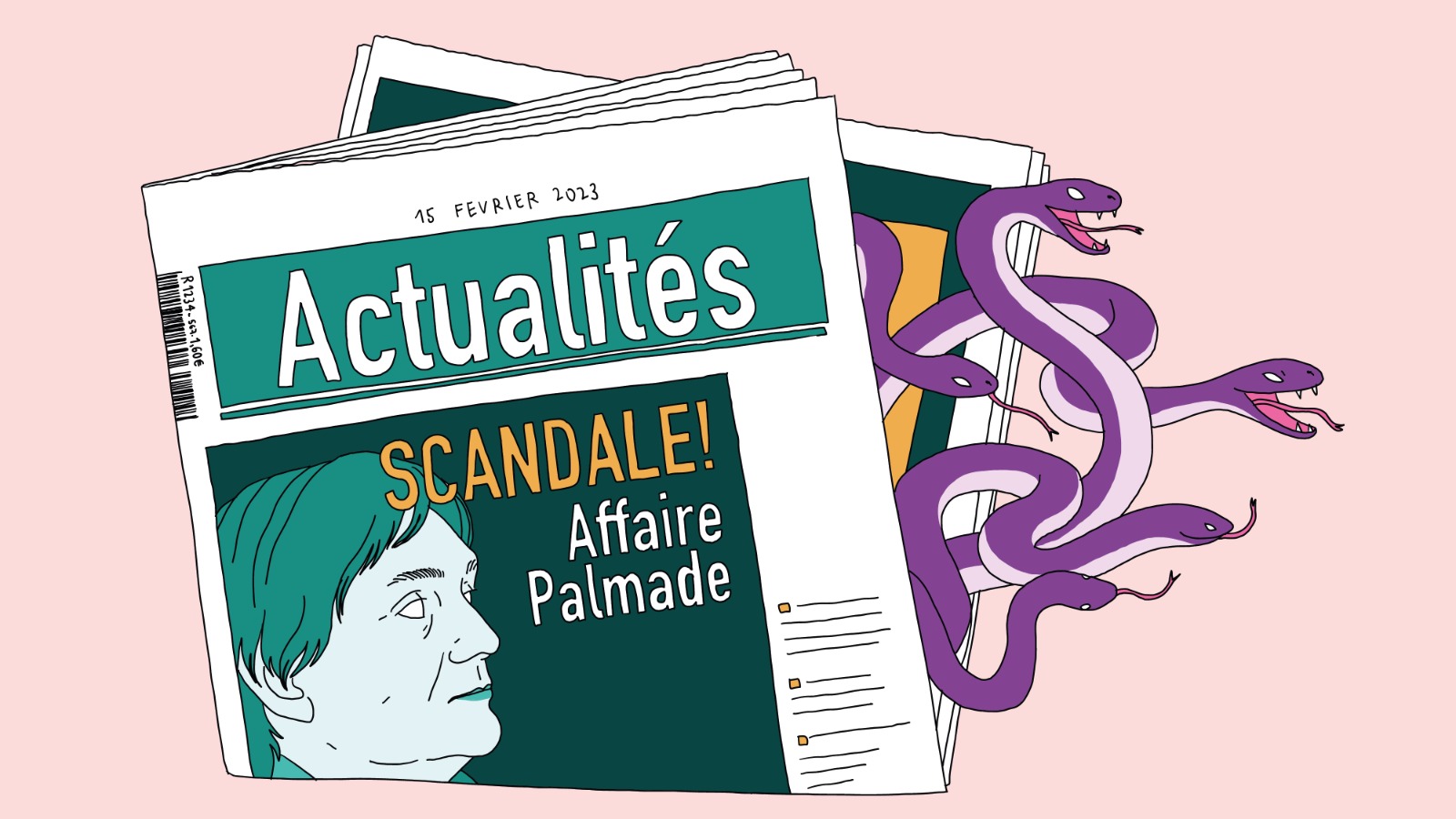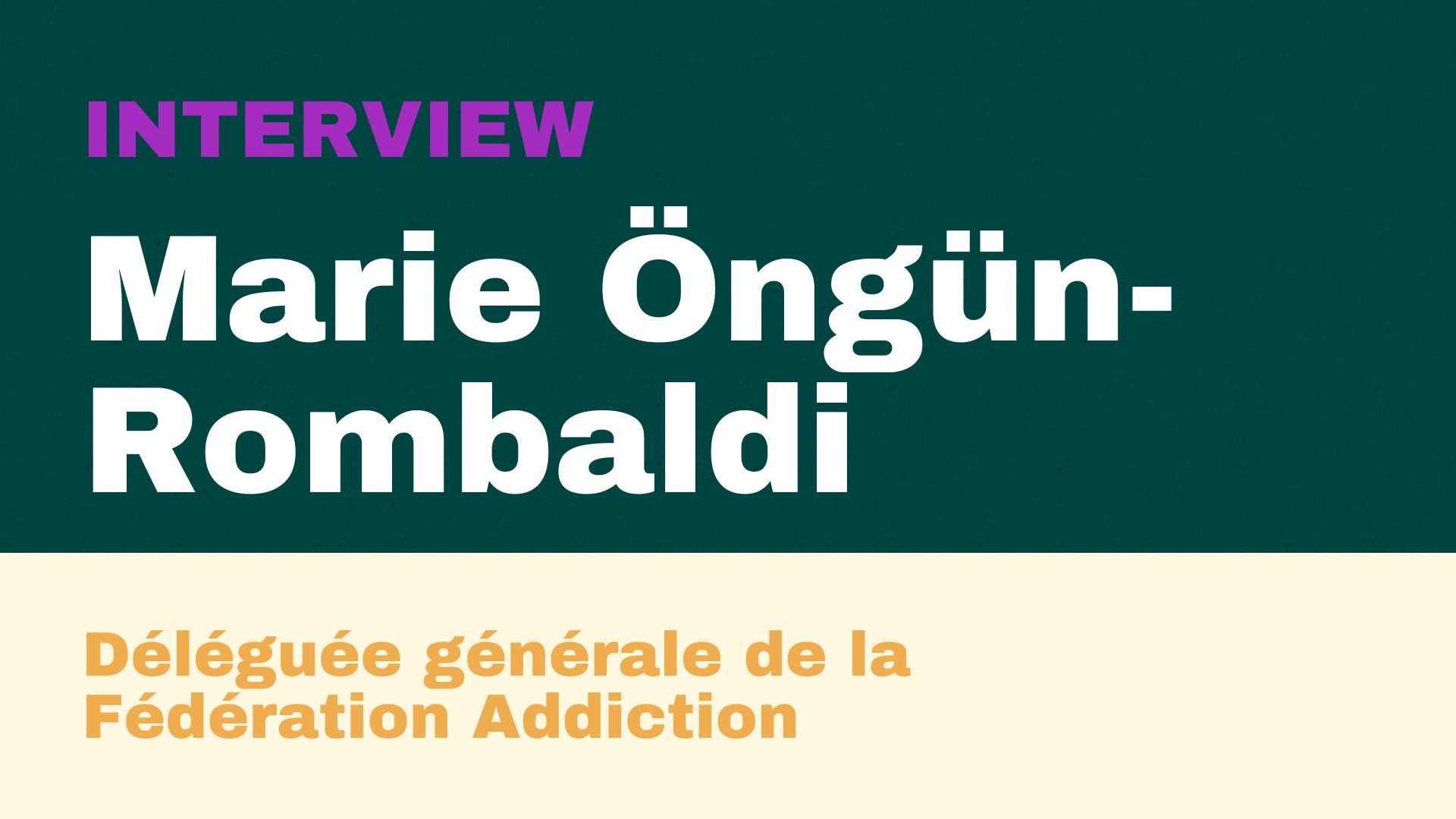Propos recueillis par Vivien Chareyre et Evann Hislers.
Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction, premier réseau d’associations et de professionnels de l’addictologie, revient sur l’impact de cette affaire médiatique sur les politiques de prévention, de réduction des risques et sur les enjeux de santé publique spécifiques au chemsex, une pratique sexuelle qui concerne principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, en général sur deux-trois jours, avec une consommation souvent intensive de produits stupéfiants, donc de drogues (voir chapitres 3 et 6).
Que pensez-vous du traitement médiatique de “l’affaire Palmade” ?
Les médias ont traité “l’affaire Palmade”de manière sensationnaliste, en cumulant les clichés. Des termes stigmatisants comme “fléau”, “cauchemar”, “invasion” ont été utilisés pour évoquer le chemsex [une pratique sexuelle qui concerne principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, en général sur deux-trois jours, avec une consommation intensive de produits stupéfiants]. On aurait aimé voir une couverture médiatique s’appuyant sur les données de la science, sur ce que disent les personnes concernées ainsi que les addictologues.
Mais cette façon de faire est symptomatique de la manière dont certaines rédactions, empreintes d’une homophobie latente, stigmatisent non seulement les consommateur·ices de drogues, mais aussi les pratiquant·es du chemsex.
Plus largement, la consommation des drogues subit un traitement binaire relevant de la morale : c’est bien ou c’est mal. Or, même si ce comportement présente des risques pour la santé, il demeure humain – prenons l’exemple de l’alcool en France. Il ne s’agit pas de banaliser cette consommation, mais ne pas non plus la diaboliser. Les personnes concernées ont avant-tout besoin d’accompagnement.
Lorsque la parole est donnée à une personne concernée dans les médias, on est souvent sur la figure du repenti ayant des regrets, voire présentant des excuses. Cela masque la réalité des consommateur·ices : certain·es gèrent bien leur consommation, tout en ayant conscience de prendre des risques. En parler permettrait sans doute de libérer la parole et de dédramatiser les situations, en encourageant les personnes à demander de l’aide.
Justement, quelles en ont été les conséquences en matière de prévention des dépendances ?
La Fédération Addictions promeut le non-jugement, la prévention et la réduction des risques. Or, ainsi pointée du doigt, le·a chemsexeur·euse a honte, se cache et hésite à consulter un·e soignant·e pour se faire aider. La personne va donc consommer de manière non sécurisée, sans avoir accès à des informations fiables. Prenons un exemple : si un·e partenaire fait une surdose, elle évitera d’appeler les urgence par peur des conséquences. La stigmatisation tue tout autant que les drogues.
Pour autant, ce traitement a-t-il pu contribuer à mettre les enjeux de santé publique spécifiques au chemsex à l’agenda politique?
Oui et non. Certain·es élu·es se sont saisi·es de la question de manière équilibrée, en s’intéressant aux données de la science, en interrogeant les personnes concernées et les associations communautaires. Malheureusement, ces élu·es sont peu nombreux·ses. Plus largement, les approches politiques du chemsex, de la consommation de drogues ou des addictions demeurent, là aussi, moralisatrices.
Il est important de replacer la couverture médiatique de cette affaire dans un contexte plus large de répression depuis une cinquantaine d’années en France. A nouveau, cela demeure délétère : se sachant dans l’interdit, les gens restent éloignés du système de soins et se mettent en danger.