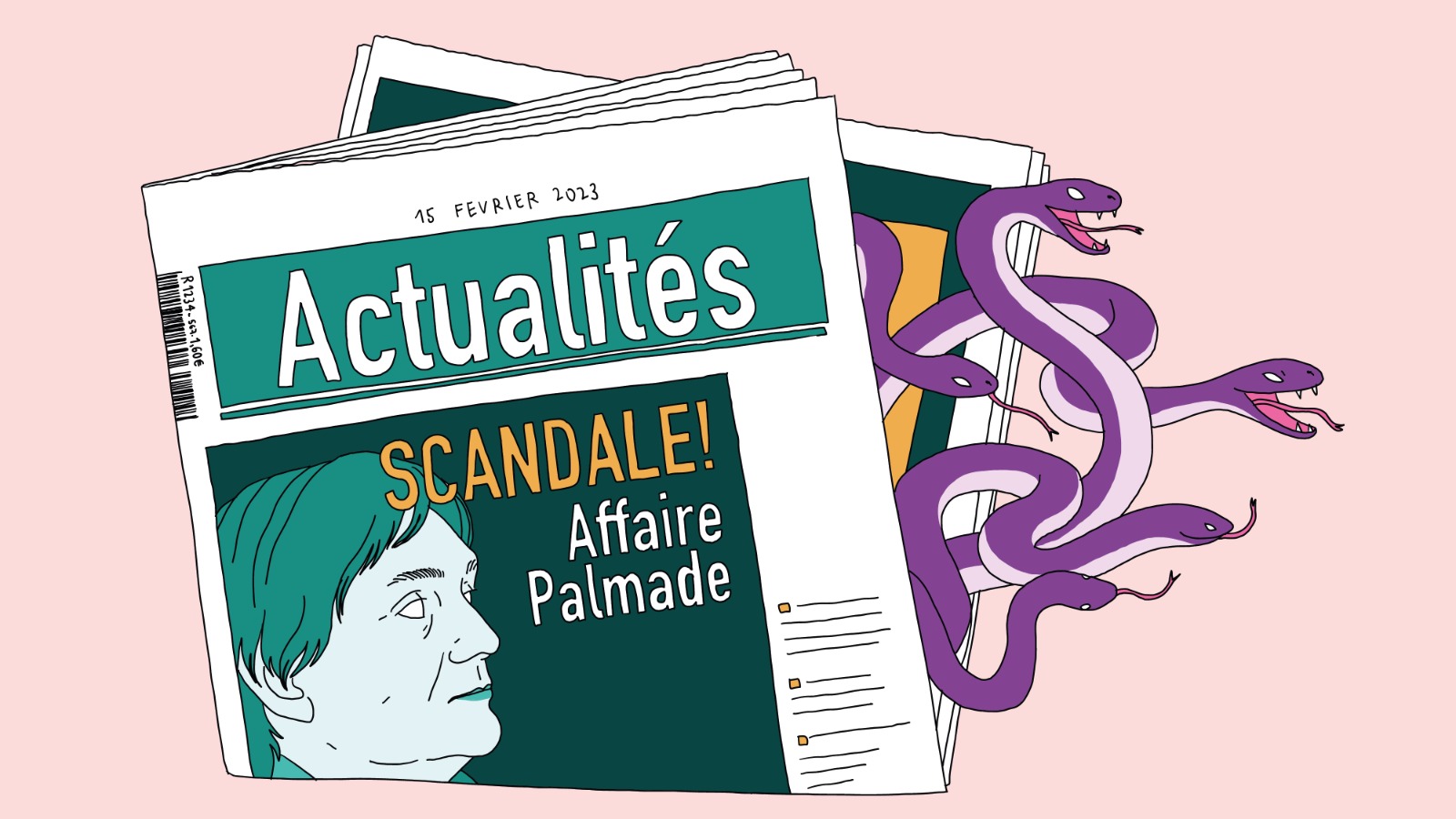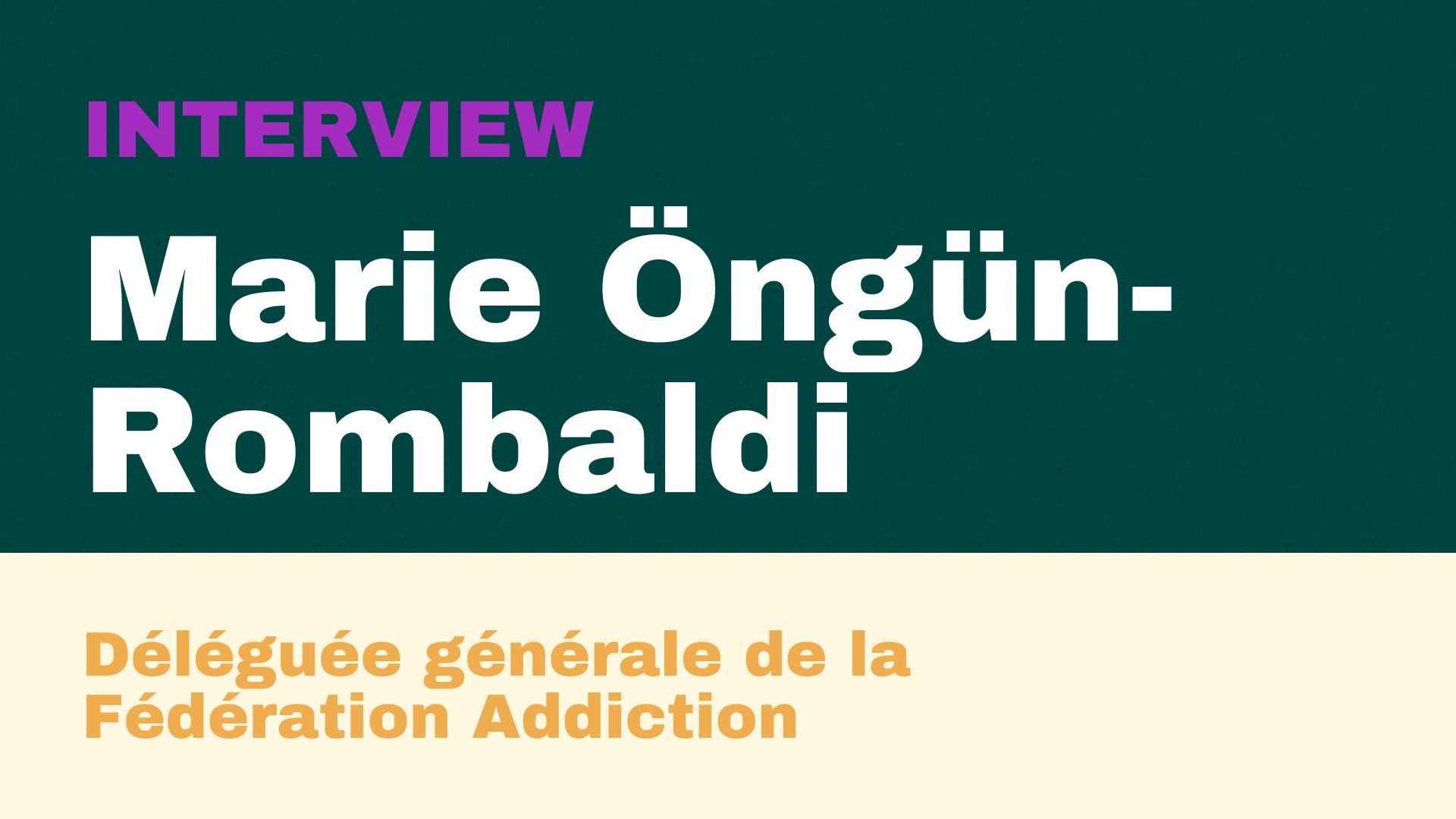L’audience n’aura duré qu’un jour.
S’il fallait se convaincre de la disproportion du traitement médiatique de “l’affaire Palmade”, il suffirait de se souvenir des quatre semaines d’intense production médiatique et d’observer, 20 mois plus tard, les quelque 90 journalistes venus au tribunal correctionnel de Seine-et-Marne couvrir le procès d’un accident de la route. Comme si, aux excès du comédien devaient répondre ceux des médias français.
Face à l’ampleur du déferlement médiatique qui a concerné “l’affaire Palmade” depuis l’accident, l’AJL a lancé une étude pour pouvoir mesurer l’ampleur du phénomène. Sur quatre semaines de couverture, du 10 février au 10 mars 2023, nos membres ont analysé 30 heures et 50 minutes de magazines de BFM TV, 6 contenus originaux publiés sur bfmtv.com, 30 articles du Parisien/Aujourd’hui en France et 43 contenus originaux publiés sur leparisien.fr.
L’AJL a notamment remarqué un traitement stigmatisant du sujet du chemsex, ponctué d’homophobie, qui relègue au second plan les données scientifiques, médicales et sociales qui l’entourent. S’appuyant sur les archives, sur le livre d’entretien de Pierre Palmade Dites à mon père que je suis célèbre ! (Harpercollins) et sur les interviews qu’il a données lors de sa promotion, les médias ont évacué la question du respect de son intimité et installé son ressenti comme grille d’analyse.
Ainsi, le terme religieux “démons” utilisé en 2019 par l’humoriste pour parler de l’alcool, des drogues, du sexe ou encore de son homosexualité, est repris tel quel et sans mise à distance par les journalistes, alors même qu’il évacue du cadre la science et la médecine et pose l’analyse en termes de bien et de mal. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le vocabulaire religieux rejaillisse au moment d’évoquer le chemsex (“adepte”, “séance”, “s’adonner”) et que la « honte » soit régulièrement invoquée pendant ces quatre semaines.
L’homophobie intériorisée de Pierre Palmade et de ses propos ne sera jamais contextualisée, encore moins déconstruite, sur les plateaux de BFM TV ou dans les colonnes du Parisien. En revanche, des « vices » aux « soirées de débauche », en passant par de supposé·e·s « déviances » et « penchants pédophiles », la vie sexuelle du comédien est passée au crible autant qu’elle est décriée. Les médias détaillent la liste des « objets sexuels » perquisitionnés, s’arrêtent sur ses pratiques et se focalisent sur ses « amis », avec une obsession pour leur âge, leur nationalité et la nature de leurs relations, définies par l’argent.
À propos des addictions de Pierre Palmade, qui ne sont pas systématiquement qualifiées de maladies, elles ne sont analysées que sous le prisme de la distinction juridique entre « alcool » et « stupéfiants », au détriment du point de vue des addictologues. Elles sont appréciées à partir de la dichotomie pénale et policière : le licite et l’illicite. D’ailleurs, adopter le point de vue de la police et de la justice est sans doute ce qui conduit BFM TV à mégenrer un témoin-clé, une femme trans, définie comme un homme durant vingt jours par les sources proches de l’enquête.
En plus des rebondissements judiciaires, l’affaire Palmade vit au rythme de deux obsessions : la mort in utero ou in vivo de l’enfant-à-naître dans l’accident et le chemsex qui, à cette occasion, fait irruption sur la scène médiatique. BFM TV et Le Parisien l’envisagent quasi exclusivement sous l’angle de la performance, avec un intérêt exacerbé sur le nombre de participants, la durée des séances et les quantités de drogues consommées. Les dimensions sociales et culturelles du chemsex sont marginalement abordées. Les « happy chemsexers », pour qui cette pratique est une source de sociabilité et d’épanouissement, n’ont pas le droit de cité.
En effet, en contrepoint de cette fascination exacerbée et sous l’effet de l’actualité, les deux médias se focalisent immédiatement sur les dangers supposés du chemsex : agressions sexuelles, contaminations, overdose, addictions, décès. Et peu importe que le seul élément chiffré dont on dispose actuellement fasse état de 24 décès liés au chemsex entre 2008 et 2018. Relevant qu’à la faveur des confinements, cette pratique s’est à la fois développée chez les hétérosexuels et chez les très jeunes adultes, BFM TV et Le Parisien font tous les deux le parallèle avec l’épidémie de Sida, non pour évoquer l’inertie des pouvoirs publics et l’inadaptation des approches de soins, mais pour insister sur les « ravages » du chemsex. Entre sensationnalisme et exotisation, les amalgames stigmatisants et les biais homophobes s’accumulent au fil des jours, et nourrissent une nouvelle panique morale : « l’épidémie de chemsex ». Pierre Palmade devient l’incarnation d’une nouvelle figure médiatique : le « chemsexeur », à la fois assoiffé de drogues et de relations sexuelles, un « déviant » guidé par les seul·e·s jouissances et goût du risque.
Enfin, par sa disproportion, “l’affaire Palmade” met en lumière de manière saillante, les travers mêmes de la production médiatique en direct, à l’heure des chaînes d’information en continu, des sites d’information et des réseaux sociaux :
- une circulation circulaire de l’information externe (entre les médias) et interne (au sein d’un même média ou d’un même groupe) qui sature l’espace médiatique ou contribue ;
- la substitution de la conversation à l’entretien et au débat (préparés, construits, coordonnées), ce qui multiplie le risque de tomber dans les écueils des approximations et du jugement moral ;
- l’injonction au rythme et à la vitesse au détriment de la nuance et de la prise de recul ;
- l’absence de garde-fous et d’autocritique.
L’AJL a établi une liste de recommandations afin de produire une information juste et respectueuse du chemsex, et appelle à favoriser le point de vue des expert·e·s (personnes concernées, addictologues, sociologues…) pour ne plus tomber dans ces écueils.