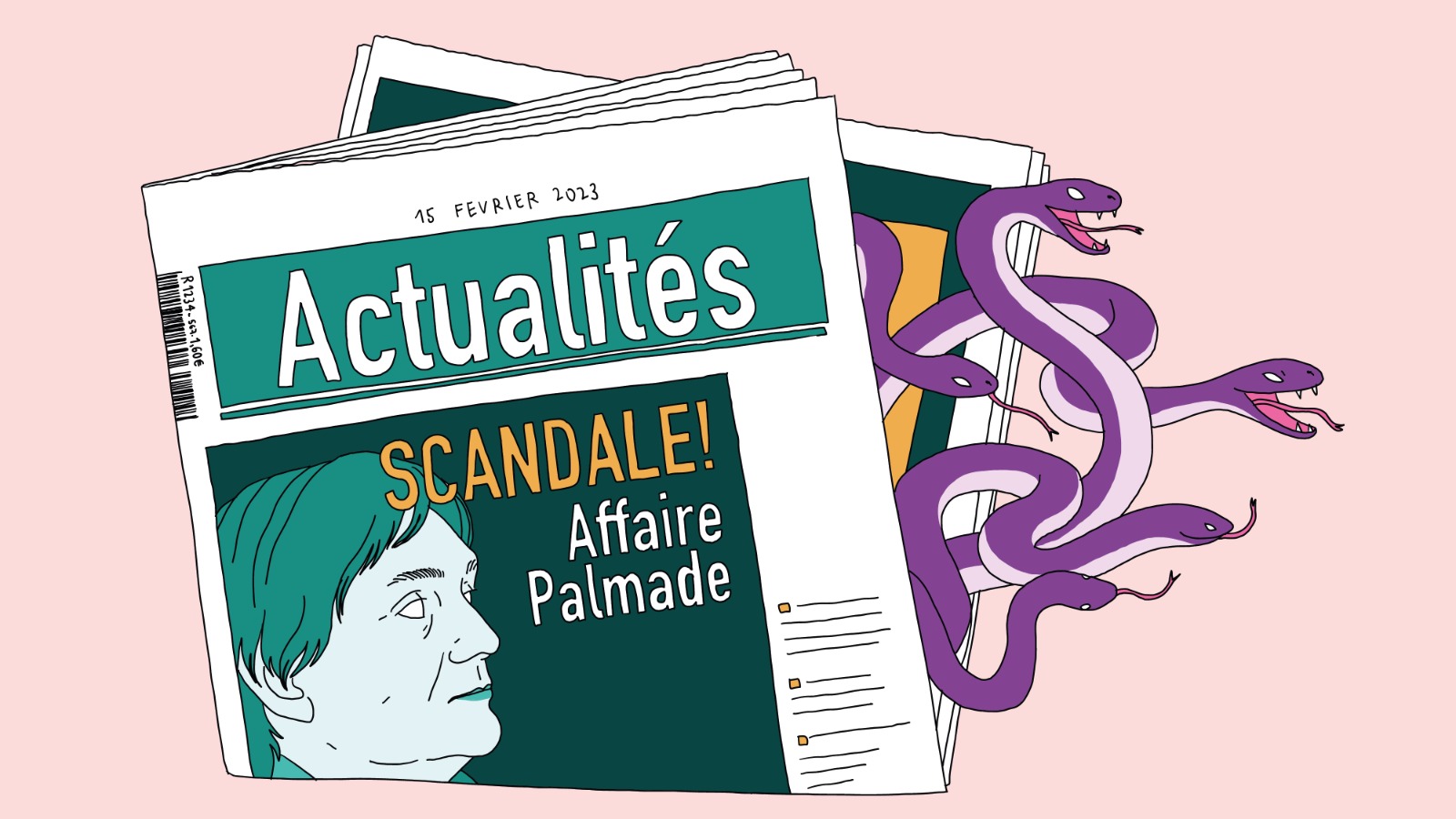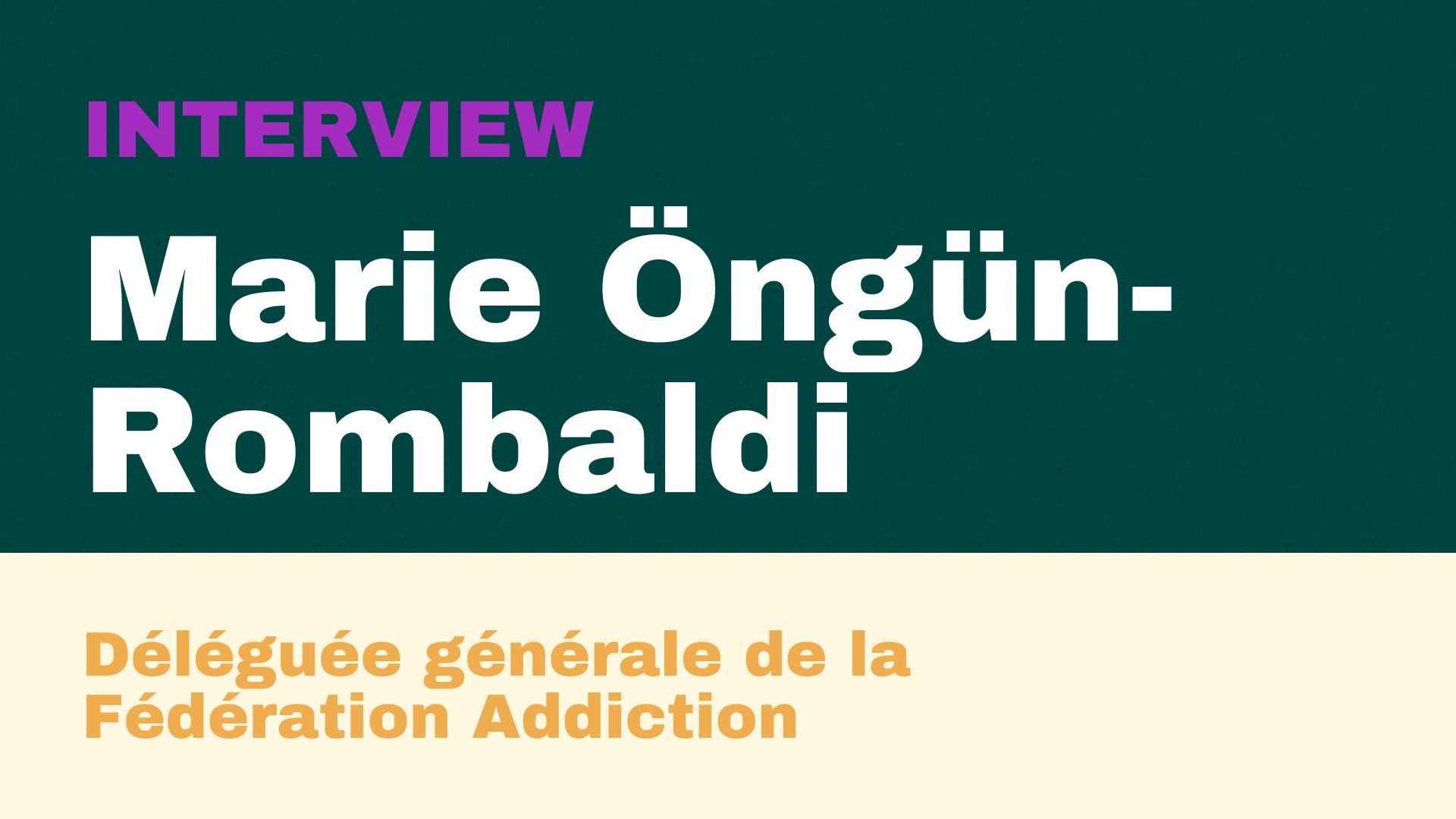“On l’appelle le Pierre Palmade de l’immeuble” : à Paris, des soirées chemsex gâchent la vie de tout un HLM. Cet article du Parisien, publié le 22 mai dernier, illustre comment, à force d’obsession médiatique, le comédien est devenu l’incarnation même du chemsex aux yeux d’une partie du grand public. La couverture de l’accident impliquant Pierre Palmade en 2023 a été l’occasion de poser toutes les questions sur ces pratiques, jusqu’à s’éloigner parfois des principes déontologiques du journalisme.
Le chemsex est un phénomène complexe à la fois social, culturel et sexuel. Il est apparu à la fin des années 2000 au sein des communautés gay occidentales, à la faveur de nouveaux modes de prévention du VIH (TasP, PreP), de l’apparition de nouveaux produits de synthèse (les cathinones comme la 3-MMC ou la 4-MEC) et de la généralisation des applis de rencontres géolocalisées. Le chemsex se caractérise par une sociabilité singulière, un souhait partagé d’initier, prolonger, améliorer les rapports sexuels, généralement en groupe, un usage de cathinones de synthèse et surtout une polyconsommation, avant ou pendant les rapports sexuels, de drogues illicites (cathinones, GHB, cocaïne, MDMA, kétamine…) et/ou licites (GBL, poppers, viagra, alcool…).
Les confinements liés à la pandémie de Covid-19, ainsi que leurs impacts socio-économiques, marquent une nouvelle séquence de l’histoire du chemsex. On constate une augmentation de sa prévalence au sein de la communauté LGBTQIA+, sa diffusion chez les personnes hétérosexuel·les et le rajeunissement des pratiquant·es.
Sur les bases statistiques de la dernière étude APACHES (Attentes & parcours liés au chemsex) en date de 2019, les réseaux professionnels du soin, de la prévention et de la réduction des risques (Fédération Addiction, Aides, OFDT) estiment qu’à l’heure actuelle :
- le chemsex concerne, à des degrés divers, autour de 20 % des HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) ;
- le chemsex concerne, à des degrés divers, autour de 15 % des FSF (femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes) ;
- plus de 8 HSH pratiquant le chemsex sur 10 sont soit sous TasP, soit sous PrEP ;
- 30% des HSH auront eu, au cours de leur vie, une expérience de chemsex ;
- le “slam” (injection intraveineuse de substances psychoactives, principalement des cathinones) est une pratique minoritaire : entre 3 et 14 %.
Le seul élément chiffré dont on dispose fait état de 24 décès liés au chemsex observés entre 2008 et 2018. L’étude APACHES appelle néanmoins à la prudence, l’apparition “récente” de ces pratiques pouvant conduire à une sous-déclaration ou à une invisibilisation statistique. La même étude souligne que la majorité des chemsexeur·euses sont inscrit·es dans une démarche volontaire de réduction des risques face au VIH (PrEP ou TasP), avec un suivi médical au long cours.
Une émergence médiatique dans le pire contexte
Si l’apparition du chemsex est relativement récente, il est, d’un point de vue de l’actualité, un phénomène désormais connu, étudié et documenté. Des addictologues, des médecins ou des psychologues formé·es et informé·es, et les réseaux professionnels du soin, de la prévention et de la réduction des risques sont en capacité d’en expliquer les intrications et les enjeux sociaux et sanitaires.
Pourtant, pendant la période que nous avons étudiée, Le Parisien n’a interrogé aucun·e addictologue sur le chemsex, hormis dans l’article “Chemsex : qu’est-ce que cette pratique sexuelle mise en lumière par l’affaire Palmade ?” qui recycle des propos de Thibaut Jedrzejewski, médecin dans un centre de santé sexuelle, déjà cités dans un dossier du quotidien un an plus tôt.
Au contraire, sur BFM TV, les addictologues, les salarié·es de centres de soins et les représentant·es d’associations de prévention et de réduction des risques ont été intensément sollicité·es pour expliquer en direct ce qu’est le chemsex. Iels représentent 15 % des invité·es interviewé·es des contenus de notre corpus1.
Mais, leur parole a été largement concurrencée. Ainsi, quand une séquence vient à aborder le chemsex, nous avons estimé2 que le rapport entre le temps de parole des professionnel·les spécialistes de l’addiction (en intégrant les rediffusions d’extraits d’interview ou de reportage) et celui des autres intervenant·es (en excluant les lancements et les commentaires des présentateur·ices) est de 1 à 7 minutes : pour 1 minute d’explication d’un·e professionnel·le de santé, le·a téléspectateur·ice recevait 7 minutes d’information, de commentaires ou d’opinion à propos du “chemsex”. Cette mise en perspective scientifique et médicale n’empêche d’aucune manière les approximations, le sensationnalisme et les jugements moraux des journalistes.
Par exemple, le 12 février 2023, dans BFM Story, le journaliste Alain Marschall fait un point sur l’enquête avec Marc Rollang, capitaine de gendarmerie, et Mélanie Bertrand, journaliste police-justice de la chaîne. Au cours des échanges, le présentateur lance : “Tout de suite, on a parlé de week-end de débauche sous chemsex. Ça s’est avéré ? C’est une certitude ?” Sur le plateau, personne ne corrige le présentateur. Il faut attendre la seconde partie de l’émission pour que Thomas Vampouille, directeur de la rédaction de Têtu, relève l’impropriété de ce terme péjoratif voire discriminatoire.
Ou bien encore, quinze jours plus tard, Bruce Toussaint, alors présentateur de BFM TV, interroge Camille – un témoin-clé des “affaires Palmade”. Le journaliste entame l’interview en demandant : “C’est quoi une soirée chemsex ?” L’invité détaille alors la commande de drogues, les différentes substances et leurs effets. “Ça ouvre la porte de l’esprit. Ça permet de penser à toutes les choses les plus tordues, perverses ou excitantes qui soient.”, déclare le témoin, usant d’un langage moralisateur et stigmatisant qui n’est pas rectifié. Au cours de l’interview, le journaliste emploie le terme “déviance” à plusieurs reprises, d’abord à propos du chemsex, puis de la vidéo dans laquelle Pierre Palmade visionnerait un contenu pédopornographique – aucune accusation n’a été retenue contre le comédien dans ce dossier.
Hypersexualisation et fascination pour la performance
Dans Le Parisien comme sur BFM TV, le chemsex est majoritairement appréhendé à travers le prisme de la performance et du dopage, avec une fascination pour la durée des sessions (“marathon sexuel”, “Ushuaïa sexuel”), le nombre de partenaires, les pratiques sexuelles (BDSM, sexualité en groupe, money slavery…) et la quantité de drogues consommées (“industrielle”, “ahurissante”, “cocktail explosif”).
L’autre angle choisi pour analyser cette pratique est celui de la désinhibition : “pour mieux assumer son homosexualité”, affirment systématiquement les commentateurs. Cette incise, répétée à l’envi, n’envisage jamais le chemsex comme une façon de mieux supporter les violences homophobes ou de rompre avec une certaine solitude, mais préfère y voir un moyen de dépasser le sentiment de honte d’être homosexuel. Ainsi, au cours des premiers jours de l’enquête, Le Parisien utilise la même expression – “un cocktail alcool-cocaïne-sexe qui lui a permis un temps de vivre son homosexualité” – dans quatre articles consécutifs. Cette formule est reprise par plusieurs journalistes ou invité·es de BFM TV. Elle apparaît d’ailleurs pour la première fois le lendemain de l’accident, dans l’un des tout premiers articles en ligne, “Pierre Palmade, une vie d’excès”3, pour introduire une citation de Dites à mon père que je suis célèbre, l’autobiographie du comédien : “A jeun, je voulais être hétéro à tout prix. Avec l’alcool et la drogue, j’ai eu la liberté d’être homo, je ne me jugeais plus, m’éclatais. Humoriste bien propre sur lui la journée, la nuit je courais les boîtes gays sans me rendre compte que je devenais dépendant à la cocaïne.”
En 35 ans de carrière, de frasques et de confidences relatées dans la presse, Pierre Palmade s’est beaucoup livré, notamment sur sa sexualité, ses addictions et ses rechutes, en particulier au moment de la parution, en 2019, de son livre. Et c’est là aussi un des enjeux du traitement médiatique disproportionné de “l’affaire Palmade” et de la représentation biaisée du chemsex : l’utilisation des archives qui compensent l’absence d’images de l’accident. Dans le reportage long format “Pierre Palmade, des vies brisées”, diffusé sur BFM TV le 17 février 2023, Jérémy Normand et Michaelle Gagnet illustrent ainsi leur démonstration sur la “descente aux enfers” du comédien avec une description extraite de son autobiographie :
“Tout se passe chez moi. Avec un mec, deux ou trois. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couchaille ensemble. Et on recommence. C’est une orgie amusante”
Dites à mon père que je suis célèbre, Pierre Palmade, HarperCollins, 2019.
Le cas particulier de Pierre Palmade et son rapport aux drogues devient un archétype, qui définirait le phénomène du chemsex, lequel recouvre pourtant une large variété de pratiques. Le même procédé est à l’œuvre quelques minutes plus tard, après de nouvelles explications du Dr William Lowenstein, addictologue et président de SOS Addictions, sur les effets d’une polyconsommation excessive de drogues. Un nouveau passage du livre de Pierre Palmade est lu :
“Je me réveille allongé sur la moquette le nez en sang. Les mecs avec qui j’ai couché sont partis depuis longtemps, me laissant me démerder tout seul (…) Les douches ne me font pas forcément du bien. Parfois, je suis tellement en manque que je picole au lieu de me laver. Je ne fais mal à personne sauf à moi”
Dites à mon père que je suis célèbre, Pierre Palmade, HarperCollins, 2019.
Ainsi, fautes d’autres représentations, ces pratiques autodestructrices sont présentées comme la définition même du chemsex, qui n’atteint pourtant pas toujours ces extrémités.
Le chemsex : un coupable tout trouvé
Le 14 février, dans “BFM Story”, les journalistes Olivier Truchot et Alain Marschall s’intéressent à l’un des deux passagers de Pierre Palmade, un escort boy, et au recours du comédien à des prestations sexuelles tarifées. Thierry Schaffauser, porte-parole du Syndicat du travail sexuel en France (STRASS), est leur invité. Après avoir été questionné sur ses tarifs et indiqué qu’il ne comptait pas Pierre Palmade parmi ses clients, ce dernier se saisit d’une relance un peu confuse d’Olivier Truchot sur le lien entre service sexuel et chemsex pour mettre les choses au clair : “je ne lierais pas cet accident (…) à la pratique du chemsex parce que la cocaïne [à laquelle a été testé positif Pierre Palmade] (…) n’est pas vraiment le produit le plus utilisé en contexte sexuel parce que…la cocaïne, ça fait débander !”
Pourtant, Le Parisien établit lui aussi le même raccourci faisant du chemsex la cause de l’accident. Au fil des perquisitions, les accumulations de détails et de formules vagues au sein des articles, propices aux fantasmes et aux amalgames, contribuent à la stigmatisation des chemsexeur·euses et perpétuent des stéréotypes homophobes : irresponsabilité, hypersexualisation et goût du risque.
“Les enquêteurs ont également retrouvé divers objets de nature sexuelle, ce qui pourrait accréditer la piste de soirées “chemsex”, c’est-à-dire d’usage de drogues intensif et dangereux en vue d’avoir des relations sexuelles.”
(Le Parisien.fr – 13 février 2023)
“Ont également été retrouvés divers objets destinés à la pratique sexuelle, ce qui pourrait accréditer la piste de soirées “chemsex” (usage de drogues intensif, voire dangereux, en vue d’avoir des relations sexuelles).”
(Le Parisien – 14 février 2023)
“Lors de leur visite, les enquêteurs avaient également découvert du poppers, une substance récréative et détournée à des fins sexuelles, du matériel d’injection ainsi que des objets sexuels de type BDSM. Ce qui accrédite la piste de soirées “chemsex”, ces soirées au cours desquelles les participants ingèrent de grandes quantités de drogue pour améliorer les performances sexuelles, prenant un risque pour leur santé et celle d’autrui.”
(Le Parisien.fr – 15 février 2023)
“Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers et gendarmes avaient saisi le téléphone de l’humoriste et avaient découvert du matériel d’injection de cocaïne, du poppers, une substance détournée à des fins récréatives, ainsi que des objets de type BDSM”
(Le Parisien.fr – 16 février 2023)
“Selon nos informations, lors de la perquisition au domicile de l’ami de Pierre Palmade, les policiers ont également saisi de la drogue — de la 3MMC, un dérivé de la cocaïne — ainsi que d’autres drogues de synthèse. Des produits notamment utilisés lors des soirées “chemsex”, au cours desquelles les participants ingèrent de grandes quantités de drogues pour améliorer leurs performances sexuelles.”
(Le Parisien – 24 février 2023)
On pourrait s’amuser de ces “inventaires à la pervers” mais leur répétition participent à véhiculer des préjugés homophobes : les pratiques BDSM, la consommation de poppers ou l’utilisation d’objets sexuels ne sont pas l’apanage des gays, et elles ne sont ni les indicateurs d’une sexualité problématique ou pathologique, ni une infraction au code pénal.
Le repenti appelé à la barre
La figure du repenti, de l’ancien consommateur de drogues, est un lieu commun du traitement médiatique des addictions alors même que les problèmes de dépendance ne concernent que marginalement les chemsexeur·euses. Ainsi, pendant notre période d’étude, à l’exception de Thierry Schaffauser, seuls des anciens chemsexeurs ont été invités sur les plateaux de BFM TV, réduisant cette pratique sexuelle à une question de danger et d’addiction.
Le 14 février dans “22h max”, Mathieu Ferhati, “ancien acteur porno, ancien escort boy, ancien chemsexeur” est l’invité de Maxime Switek. Il y évoque avec pudeur et clarté son expérience, rappelle qu’il a commencé pour satisfaire ses clients eux-mêmes chemsexeurs et que, le concernant, le chemsex a été synonyme d’addiction. Quand une chroniqueuse lui demande si la honte que les chemsexeurs peuvent éprouver les empêcherait d’appeler les secours en cas d’overdose d’un participant, il répond : “Ça ne me serait pas passé par la tête. C’est la conscience de chacun, on fait avec sa conscience. Moi, je n’aurais pas pu abandonner un ami.”
Toujours le 14 février, sur le plateau de “90 Minutes”, Aurélie Casse reçoit Loïc Michaud, ancien chemsexeur devenu conseiller dans un centre de santé et de réduction des risques à Genève. Après quelque quarante minutes de propos stigmatisants – aux “démons” de Pierre Palmade succèdent les “adeptes” qui “s’adonnent” au chemsex-, Loïc Michaud intervient brièvement en fin d’émission pour reposer le cadre du débat :
- “La majeure partie des personnes qui pratiquent le chemsex ne sont pas dans des situations problématiques.”
- “Quand [les chemsexeurs] parlent avec moi, ils ne se sentent pas stigmatisés (…). On doit tous et toutes être vigilant·es avec les propos qu’on utilise en lien avec cette affaire ou quand on parle de dépendance, à ne pas stigmatiser. Je crois que la stigmatisation tue tout autant que la politique de répression des drogues.”
Loïc Michaud redit la nécessité d’être précis quand on parle de chemsex, pratique qui se “caractérise par la prise de substances avec l’intentionnalité d’avoir du sexe”. Il est d’ailleurs gêné par la position de Yann Botrel, hypnothérapeute, invité également, qui parle de “porosité” [entre les chemsexeurs et les jeunes] ; ce dernier confond chemsex et consommation de nouveaux produits de synthèse. Loïc Michaud précise : “Dire qu’il y a une porosité m’embête (…) Ce qui est poreux, c’est l’accessibilité à ces [nouvelles] substances”.
Quelques contenus présentent néanmoins une vision plus nuancée et équilibrée de la pratique du chemsex. Voix trafiquée, filmé de dos et à contre-jour, Boris est lui aussi un “repenti” – il est d’ailleurs filmé comme les repentis, ces ex-membres de la mafia qui, en échange de protection, collaborent avec la justice. De l’excitation des premières sessions à la prise en charge de son addiction, son parcours sert de fil rouge à un reportage de Yanis Choutier (ancien coprésident de l’AJL) mis en ligne le 16 février 2023, qui dresse un panorama complet du chemsex. Philippe Battel, addictologue, y explique notamment certaines propriétés des cathinones, à la fois entactogènes (elles facilitent le contact avec l’autre et exacerbent les sensations) et empathogènes (elles amplifient les capacités d’empathie et l’impression de se mettre à la place de l’autre). C’est l’une des rares fois où cet aspect du chemsex est abordé, dépassant la fascination pour les qualités dopantes de ces drogues.
Témoignage rare, là aussi publié sur le site de BFM, celui de Logan et Hugo, un jeune couple de “happy chemsexers”, pour reprendre le terme de l’étude APACHES 2019. “Le sexe est 10 fois mieux. Dès que j’en prends, mon désir est décuplé”, décrit Logan, un Alsacien de 21 ans. Hugo, lui, a été initié à 19 ans : “J’étais avec un homme plus âgé à l’époque, qui m’a proposé de tester pour être plus à l’aise. Et ça a tout changé : d’un coup je n’avais plus peur, plus mal, le sexe pouvait durer des heures et des heures.”
La journaliste Jeanne Bulant précise qu’à 23 ans désormais, Hugo admet avoir un “rapport ambivalent” au chemsex et appelle à la mesure. En complétant ces deux témoignages avec le parcours de “Nicolas”, un jeune gay de 24 ans qui, après six ans de chemsex, ne veut plus en entendre parler et avec les expertises de Loïc Michaud et de Fred Bladou, en charge du sujet au sein de l’association Aides, Jeanne Bulant signe là un article qui montre bien la complexité de cette pratique.
L’obsession du danger et le parallèle douteux avec le VIH/sida
A la fascination qu’exerce le chemsex en termes de performance et d’hypersexualisation répond une obsession toute aussi grande pour ses “dangers”. Dans les deux cas, le registre est celui de l’hyperbole. L’échange du 12 février 2023 entre Thomas Vampouille, directeur de la rédaction de Têtu, et les présentateurs de “BFM Story”, Olivier Truchot et Alain Marschall, est édifiant quant à la méconnaissance du sujet, voire à l’impréparation de l’entretien (“Attendez, [le chemsex], c’est un aphrodisiaque comme le viagra ?”) et à l’obsession pour ses dangers.
Thomas Vampouille aura dix minutes en cumulé pour répondre à 21 questions alors qu’en bas de l’écran les bandeaux “Chemsex: des pratiques dangereuses” et “Sexe & drogue: les liaisons dangereuses” se succèdent, ce qui ne lui laisse pas suffisament de temps pour apporter toutes les nuances et rectifications nécessaires. Néanmoins, après avoir rappelé que “le chemsex, ce n’est pas une drogue, c’est une pratique”, Thomas Vampouille remet les pendules à l’heure quand, par syllogisme, Olivier Truchot fait du chemsex la cause de l’accident :
– Thomas Vampouille : “Il faut quand même faire attention parce qu’il y a deux problèmes dans cette histoire. Il y a le problème de la sécurité routière et le problème du chemsex. Il est évident qu’on ne conduit pas sous l’emprise d’un produit psychoactif que ce soit des drogues ou de l’alcool. (…) Mais quand on parle de débauche et qu’on dévoile ce que [les enquêteurs] ont trouvé, des jouets sexuels…
– Olivier Truchot : “On mélange tout ?
– Thomas Vampouille : “On mélange tout, oui ! Il y a quand même plus de 1 000 accidents mortels par an, je n’entends pas que tous les dimanches, on fasse des émissions spéciales sur les pratiques des hétéros qui ont renversé et tué quelqu’un.”
Olivier Truchot enchaîne alors sur les “morts toutes les semaines à cause du chemsex”, “ses ravages” avant d’évoquer un titre supposé du New York Times : “Le chemsex, c’est le Sida N°2”. “Le Sida N°2… des gays”, ajoute-t-il. Rien ne prouve pourtant qu’on meurt toutes les semaines à cause du chemsex, comme nous le disions plus haut. Thomas Vampouille aura à peine le temps d’appeler à la prudence : “Attention, à ce genre de slogans ! Je sais que nous autres, journalistes, on aime faire des titres…” qu’une autre question lui est posée. La capture d’écran d’un article de Slate datant d’avril 2021 titré “Le chemsex, ce ‘sida numéro 2’ qui inquiète” sera néanmoins, à nouveau, à l’écran trois minutes plus tard.
Au terme de l’entretien, le rédacteur en chef de Têtu aura rapidement précisé que ces “ravages” concernent parfois “ceux qui tombent dans la dépendance” et “qu’on a dû mal à les mesurer : on a fait un dossier de trente pages dessus (…) et les pouvoirs publics ont du mal à mesurer.” Cette mise au point n’empêchera pas, deux jours plus tard, Olivier Truchot d’instrumentaliser cette interview face à Thierry Schaffauser. Confondant consommation de cathinones et chemsex, le journaliste interroge le porte-parole du STRASS sur la “popularisation de cette pratique” : “On en a un discuté avec un journaliste de Têtu qui a fait une enquête dessus, qui dit que ça peut provoquer des drames, parfois même des morts (…) Toutes les semaines, sans prendre le volant, des jeunes en meurent en prenant trop de produits (…) C’est une réalité. Les chiffres sont assez alarmants”. Aucune source précise n’est citée, aucun chiffre n’est avancé.
C’est d’ailleurs à plusieurs reprises et sans aucune prise de recul que BFM TV et Le Parisien établissent un parallèle entre la pratique du chemsex et l’épidémie de sida. Dans le seul article qu’il consacre au sujet, pendant notre période d’étude, Le Parisien, après avoir rapidement parcouru les risques médicaux que peuvent encourir les chemsexeur·euses, renvoie vers un article du magazine Néon sur “l’épidémie qui vient”.
Dans l’article de Slate (2021) comme dans l’enquête de Néon, “Chemsex, l’épidémie qui vient” (2021), apparaît bien l’expression “deuxième Sida”, sans que sa paternité en soit précisée. Quant à l’article du New York Times, cité par Slate, il s’agit en fait d’une tribune publiée en 2020 par un responsable communautaire, qui ne pointe pas tant la létalité de la pratique du chemsex que l’inertie des pouvoirs publics et l’inadaptation des approches de soins. Deux points qui rappellent effectivement les premières années de l’épidémie de sida.
Dernier élément sur les dangers supposés du chemsex et leur ampleur abordé dans ce même article du Parisien mis en ligne le 16 février 2023 : ce dernier conclut par la mention d’un courrier adressé à la préfecture de Paris par “un officier de liaison LGBT” alertant sa hiérarchie :
- “Ce phénomène du chemsex prend une telle ampleur qu’il s’étend désormais à la population hétérosexuelle, notamment auprès des jeunes.”
- “Outre le risque de dépendance, de contamination aux maladies sexuellement transmissibles et de décès, le chemsex induit également de multiples viols, agressions sexuelles ou violences.”
Là encore, ces informations ne sont ni étayées ni chiffrées dans l’article, qui conclut en confondant maladroitement le nombre de décès liés à l’usage de nouvelles drogues de synthèse et le nombre de décès liés au chemsex : “En 2021, près d’un tiers des overdoses mortelles dans la capitale et dans la petite couronne, soit 9 décès, étaient liées aux drogues de synthèse, ces produits psychoactifs créés chimiquement. Sur ces 9 overdoses, 7 faisaient suite à une absorption de 3-MMC, le nouveau produit qui fait fureur au point de supplanter les drogues de synthèse ‘historiques’ comme l’amphétamine, la méthamphétamine ou la MDMA.”
Un amalgame qui, là encore, renforce l’idée reçue d’une dangerosité incontrôlable de la pratique du chemsex et d’une inconséquence des chemsexeur·euses.
- Nous avons comptabilisé pour chaque contenu de BFM de notre corpus d’étude, les personnes interviewées qu’elles soient en plateau, en visio ou enregistrées en amont de l’émission. Nous en avons exclu les présentateurs et les journalistes en duplex. Les chef.fes de service et les journalistes spécialistes de BFM sont intégré.es au calcul puisqu’iels participent au débat. Les rediffusions d’interviews sont également comptabilisées.
- Nous avons comptabilisé pour les émissions de BFM, le temps de paroles des professionnel·les spécialistes du chemsex (médecins et psychologues addictologues, salarié.es d’association de soins, de prévention et de réduction des risques) et celui des autres intervenant·es (en excluant les lancements et les commentaires des présentateur·ices). Nous avons fait de même pour les contenus originaux publiés sur le site de BFM. Quand il s’agit d’un article, nous avons comptabilisé le nombre de signes des professionnel·les spécialistes du chemsex et celui des autres personnes interviewées. Dans les deux cas, les rediffusions ou les citations d’interviews sont intégrées à ce décompte. Le décompte commence dès lors que le thème du “chemsex” était abordé, qu’il soit ou non appréhendé avec justesse.
- L’article était initialement titré “Pierre Palmade, un angoissé drôle à l’excès”