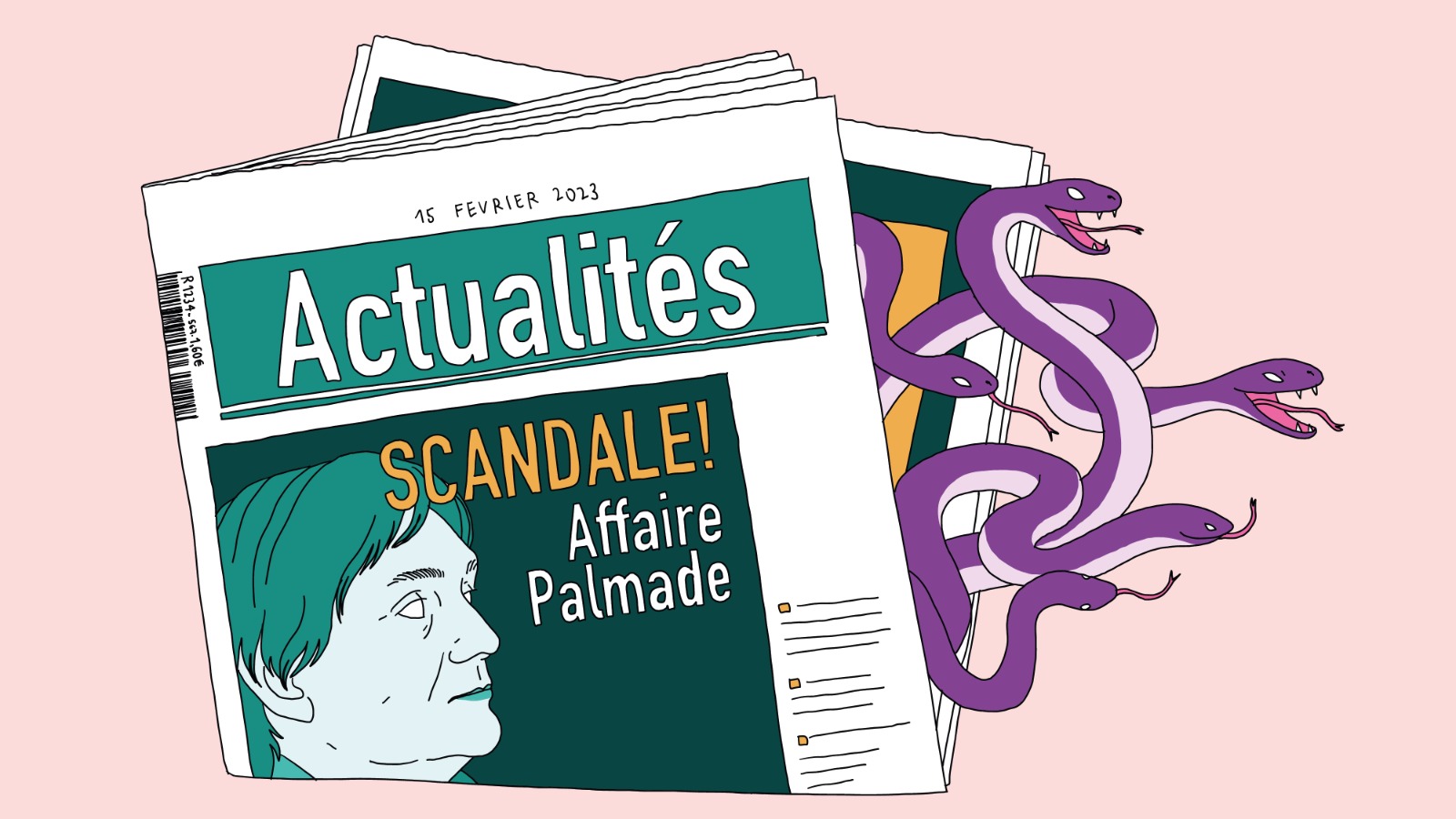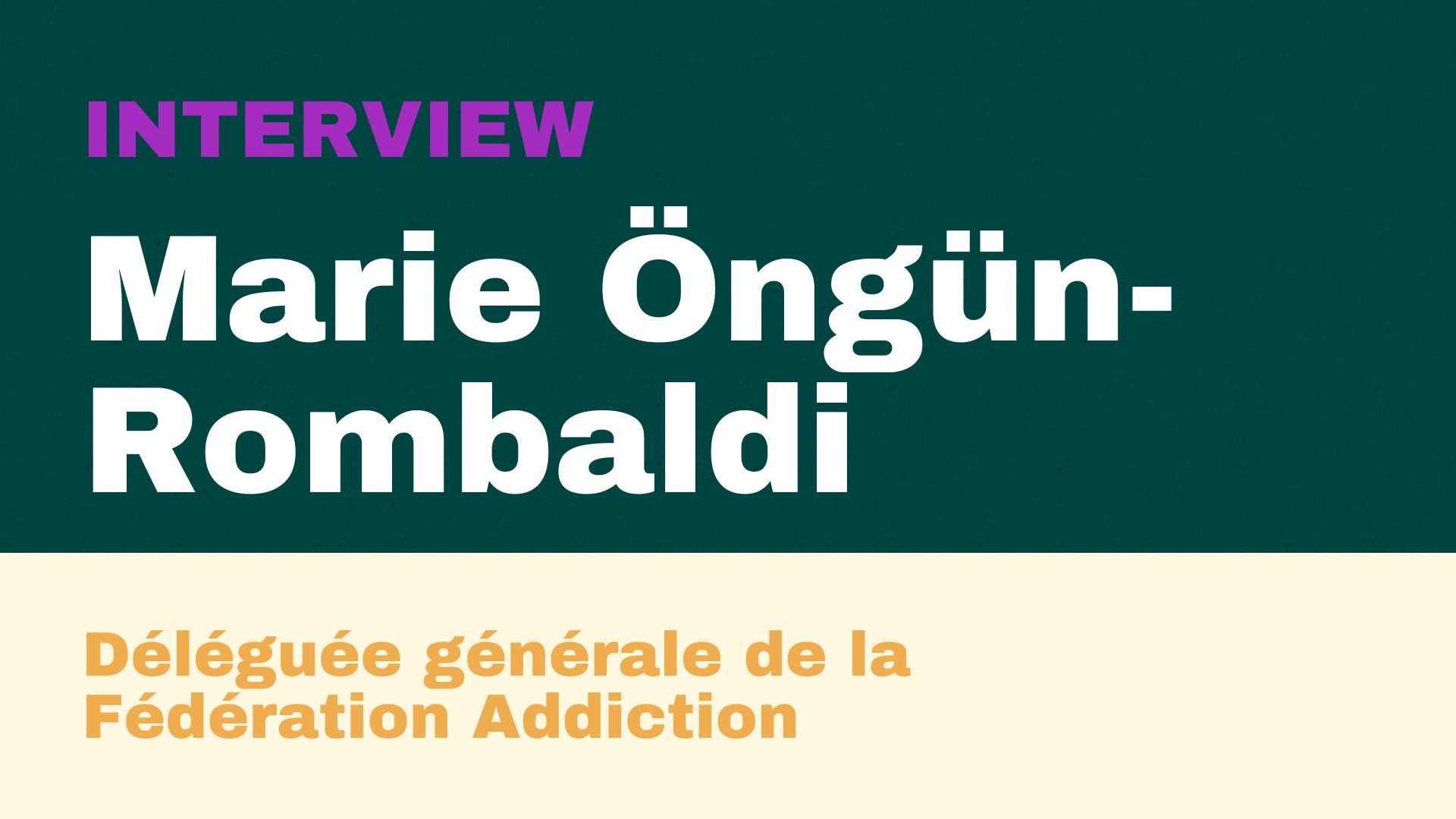Propos recueillis par Clément Giuliano
Comment expliquer un tel emballement autour d’un fait divers somme toute tristement banal ? Quels préjugés charrie et renforce ce phénomène médiatique qui a feuilletonné à l’envi sur la vie privée de Pierre Palmade ? Pourquoi certains médias ont-ils aussi mal traité la question de la dépendance et du chemsex1 ? Lucile Jouvet Legrand, maîtresse de conférences en socio-anthropologie, spécialisée notamment dans le traitement des faits divers, analyse les mécanismes à l’œuvre dans la fascination pour cette affaire.
Pensez-vous que l’accident de Pierre Palmade a fait l’objet d’un traitement disproportionné par les médias français ?
Pour un accident de voiture impliquant un conducteur sous l’emprise de stupéfiants, oui, sans aucun doute. Ce type d’accident arrive malheureusement quotidiennement – l’alcool et la consommation de stupéfiants étant l’une des principales causes de mortalité routière2. Dans le cas de “l’affaire Palmade”, plusieurs éléments ont contribué à cristalliser l’intérêt du grand public.
A partir du moment où une célébrité est impliquée, les médias vont davantage parler de ce fait divers. Dans le cadre de cet accident, le capital d’identification est important : beaucoup de personnes ont pu se projeter dans les différentes émotions d’un parent perdant son enfant. À cela s’ajoute une pratique peu ou mal connue, le chemsex. Ces éléments forment un cocktail parfait pour susciter l’intérêt du public et des médias.
Cet intérêt accru des médias a donné lieu à un traitement discriminatoire, comme le démontre l’étude de l’Association des journalistes LGBTQIA+ (AJL)…
Dans cette affaire, il y a un phénomène de bouc émissaire. En psychologie sociale, on parle de « quadrant maudit » pour décrire les préjugés hostiles et l’absence d’empathie. Plus les faits concernent des personnes « étrangères », plus le regard du grand public sera froid et sévère. En étant une personne homosexuelle se livrant à des pratiques sexuelles jugées différentes de la norme, Pierre Palmade a chuté dans ce « quadrant maudit », alors même qu’il était célèbre et apprécié. Dès lors, son histoire sort des sentiers battus. La presse va mettre en exergue sa consommation de drogues, porter un jugement sur ses pratiques sexuelles… quitte à caricaturer et à renvoyer à des mythes collectifs partagés. De la même manière que tout un pan de la population française ne prend plus la peine de dissimuler son racisme, on va constater une libération de la parole homophobe dans l’espace médiatique.
L’AJL appelle régulièrement les médias à ne pas relayer des propos homophobes…
En effet, ce traitement médiatique et la focalisation sur le chemsex – une pratique pourtant marginale – ont pu renforcer les préjugés. J’y vois, en outre, un parallèle avec les campagnes discriminatoires qui étaient développées au moment de la colonisation, où les peuples colonisés étaient présentés comme des “sauvages” et des “sodomites”. Il y avait une mise en scène d’une sexualité dite “animale”, par opposition aux peuples prétendument « civilisés ». Ces images-là perdurent dans les préjugés colonialistes et suprémacistes vis-à-vis des minorités ethniques mais aussi celles sortant de la norme hétérosexuelle.
Ce traitement médiatique et la focalisation sur le chemsex ont pu renforcer les préjugés des homophobes
Lucile Jouvet Legrand, Maîtresse de conférences en socio-anthropologie Université de Franche-Comté
Pensez-vous que les chaînes d’information en continu favorisent le buzz autour d’un fait divers comme celui de l’accident de Pierre Palmade ?
Le phénomène de la « fausse alerte permanente » de la part des médias n’est pas nouveau dans le domaine des faits divers. Le format en continu contribue à exacerber cette tendance. Ces chaînes, qui ont besoin de nourrir le vide, vont faire de l’actualité à partir de pas grand-chose – par exemple, les images en boucle devant l’hôpital où était soigné Pierre Palmade, alors qu’il ne s’y passait strictement rien.
- Le chemsex désigne un souhait partagé d’initier, prolonger, améliorer les rapports sexuels, généralement en groupe, un usage de cathinones de synthèse et surtout une polyconsommation, avant ou pendant les rapports sexuels, de drogues licites et illicites.
- La dernière mouture de l’étude SAM (Stupéfiants et Accidents Mortels), en date de 2016, estime la seule consommation de cannabis responsable de 4% des accidents mortels. Un conducteur testé positif à ce produit multiplie par 1,65 son risque de causer un accident mortel. Ce chiffre double sous cocaïne. Le mélange stupéfiants et alcool le multiplie par 29.
En 2022, selon les chiffres communiqués par la Midelca, 672 personnes ont été tuées dans un accident de la route impliquant un conducteur sous stupéfiants et 1 décès sur 5 implique un conducteur ayant consommé une drogue, licite ou illicite, ce qui comprend l’alcool et les stupéfiants.