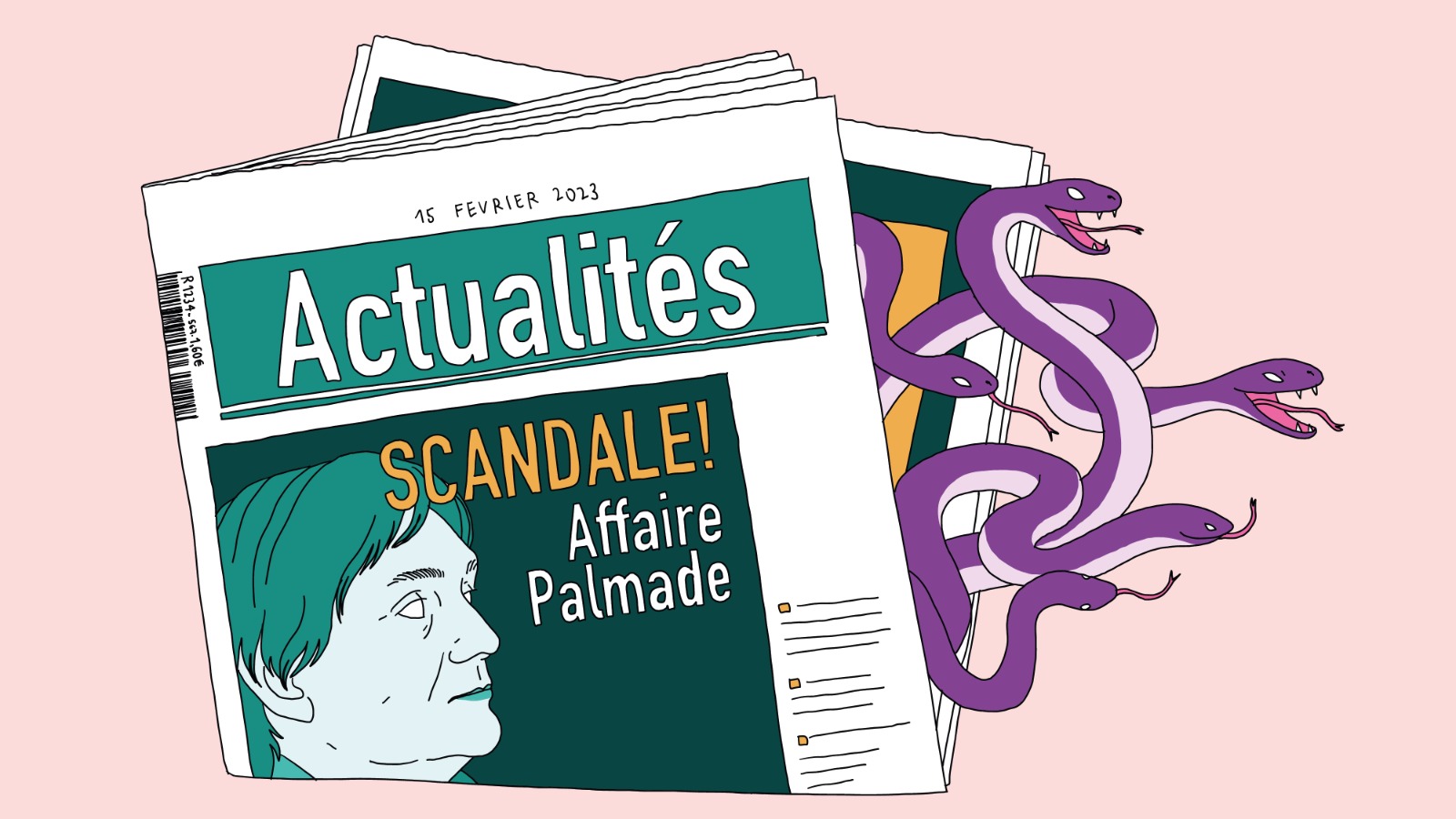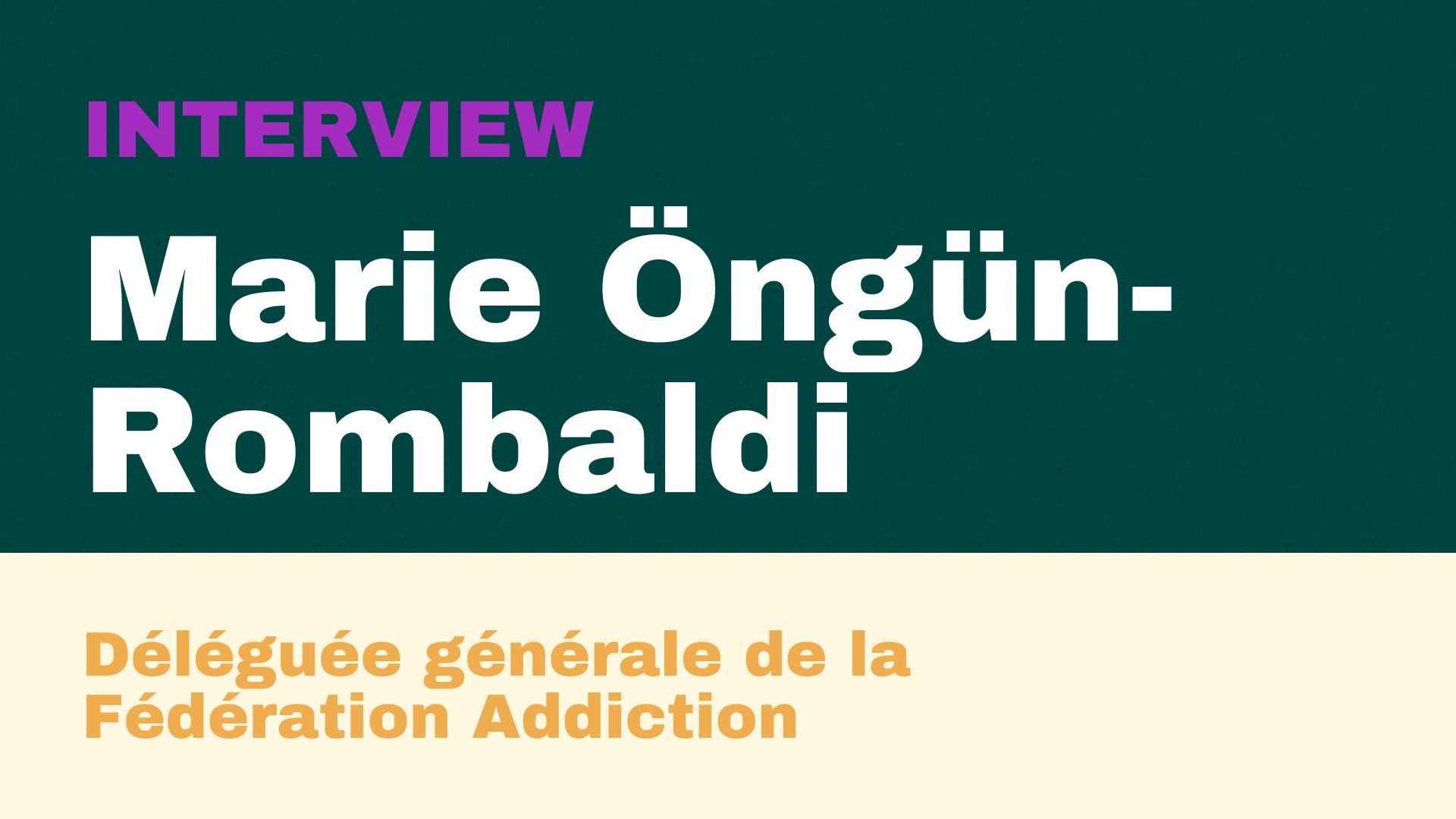Aborder les enjeux de santé publique, et a fortiori ceux de la dépendance aux drogues ou du chemsex, requiert une compétence que toustes les journalistes ne possèdent pas. Par maladresse ou par manque de formation, iels emploient parfois des termes approximatifs, inexacts voire dépréciatifs. Comme dans notre kit à l’usage des rédactions “Informer sans discriminer”, nous proposons, pour une information plus juste et plus efficace, d’utiliser consciemment des mots respectueux. Une posture qui, au-delà d’une impossible exigence d’objectivité, permet d’assurer un traitement plus équitable, en pariant sur l’exactitude du propos et en s’éloignant du langage des institutions médicales, judiciaires et policières et de leurs impensés. Sur la base des préconisations du Réseau international des consommateurs de drogues, qui travaille auprès d’organisations internationales comme les Nations unies, nous avons listé des recommandations pour mieux couvrir ces sujets :
- Mettre l’accent avant tout sur la personne, ne pas la définir par son usage de drogues ou sa pathologie, ne pas s’adresser aux personnes concernées comme à des enfants ou des victimes.
- Choisir des mots valorisant les capacités et les responsabilités des personnes, mettre l’accent sur l’action et le choix plutôt que mettre les personnes en situation de passivité : on dira par exemple “vous avez décidé de suivre un programme de désintoxication” plutôt que “vous êtes en désintox” (ou pire “vous avez suivi une désintox”).
- Documenter et préparer votre intervention que vous soyez ou non spécialiste du sujet, se renseigner sur les dernières actualités et débats, s’appuyer prioritairement sur vos collègues des services sciences ou santé plutôt que celleux des services police-justice et si vous n’avez pas le temps de bien préparer, déléguer à vos collègues formé·es et informé·es – cela permettra par la même occasion de varier les voix et de rythmer votre contenu.
- S’appuyer sur les réseaux, les associations et les institutions spécialistes du sujet, inviter des expert·es et des personnes concernées et ne pas oublier : tous les médecins ne sont pas addictologues, tous les consommateurs de drogues ne pratiquent pas le chemsex, tous les magistrats ou les policiers ne sont pas formés aux enjeux de santé publique et de réduction des risques, et toustes les expert·es ne sont pas des hommes.
- Éviter la banalisation, la diabolisation, le sensationnalisme ou la victimisation des personnes ou de la consommation de drogues en écartant les formules pathétiques ou familières. Bye bye les “il est accro”, “il souffre de son addiction”, “il s’est fait rattraper par ses démons” !
- Vérifier les termes que vous souhaitez utiliser avec les personnes concernées et les expert·es que vous invitez, profiter de leur expérience et de leurs connaissances?
- Être attentif·ve au contexte de l’échange : certains mots peuvent être utilisés au sein d’une communauté par usage professionnel ou par revendication identitaire, mais peuvent être stigmatisants s’ils sont employés hors de ces contextes spécifiques.
- En plateau ou en studio, se rappeler que la personne concernée ou l’expert·e est en situation de minorité parmi des journalistes ou des chroniqueur·euses qui se connaissent. Il faut lui garantir des conditions sereines pour qu’iel puisse exprimer son point de vue.
- Se rappeler enfin que la communication n’est pas uniquement verbale, maîtriser le ton de sa voix et son langage corporel.
Choisir des termes bien compris et qui relfètent l’évolution des réflexions sur la santé publique et sur la question des addictions est essentiel :
- On appelle “drogue” toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central ou qui modifie les états de conscience. Les drogues sont soit légales (alcool, nicotine, médicaments) ou illégales. En conséquence, on ne juxtapose plus et on n’oppose plus “l’alcool” d’un côté et “la drogue” de l’autre. Il faut rectifier le cas échéant quand quelqu’un·e emploie cette distinction erronée.
- Toutes les drogues ne sont pas des stupéfiants. En France, les stupéfiants désignent seulement les drogues illicites. Il s’agit là du terme employé par le droit et les réglementations en vigueur. Ce n’est pas un terme médical ou de santé publique. L’alcool n’est pas un stupéfiant, le cannabis l’est. Quant aux nouvelles drogues de synthèse, elles deviennent des stupéfiants dès lors que les autorités de santé et le législateur ont statué. Sinon, elles sont un angle mort.
- On évite l’argot (“junkie”, “crackhead”, “crackeur·euse”, “junky”, “toxico”, “tox”) et le jargon professionnel (UD pour “usagers de drogue”, “un·e injecté·e”…) qui déshumanisent la personne et dénotent au mieux une forme de désinvolture, au pire un jugement moral ou un manque de considération.
- De même, comme toutes les personnes malades, les personnes ayant une dépendance aux drogues ne sont pas des “patient·es”, terme encore trop souvent employé par le corps médical alors que la notion est largement dépassée : les personnes malades ne sont pas passives, elles ne se contentent pas d’être prises en charge par une équipe médicale, elles sont actrices de leur santé et de leur protocole thérapeutique.
- On abandonne aussi les termes “drogues récréatives”, “usage récréatif de drogues”, “consommation récréative” pour évoquer une consommation occasionnelle ou irrégulière de drogues, souvent dans un cadre festif. Les personnes consomment des drogues pour de nombreuses raisons et elles peuvent qualifier, vivre, percevoir leur usage de drogues comme étant “récréatif” alors même qu’il est régulier ou fréquent, et qu’elles en sont dépendantes.
- Quant au chemsex, impossible de s’appuyer sur les dictionnaires pour bien le définir : le mot n’y a pas encore ses entrées. En revanche, on peut se reposer sur l’expertise des réseaux de santé et des personnes concerné·es. Le chemsex, ça n’est pas le simple fait d’avoir des relations sexuelles sous substances psychoactives (comme l’alcool). Et ça n’a strictement rien à voir avec la “soumission chimique”.
Le chemsex est un phénomène complexe à la fois social, culturel et sexuel. Il est apparu à la fin des années 2000 au sein des communautés gay occidentales, à la faveur de nouveaux modes de prévention du VIH (TasP, PreP), de la généralisation des applis de rencontres géolocalisées et de l’apparition de nouveaux produits de synthèse (les cathinones comme la 3-MMC ou la 4-MEC). Le chemsex se caractérise par une sociabilité singulière, un souhait partagé d’initier, prolonger, améliorer les rapports sexuels, généralement en groupe, un usage de cathinones de synthèse et surtout une polyconsommation, avant ou pendant les rapports sexuels, de drogues licites et illicites.
- On préfère enfin la notion de dépendance à celle d’addiction. Considérée comme un type de maladie, fondée sur un ensemble de symptômes qui classe les personnes comme dangereuses, sans autonomie propre, incapables d’agir ou de décider, la notion médicale d’addiction est désormais fortement contestée. En revanche, les addictologues qui peuvent être soit des médecins, généralistes ou spécialistes, soit des psychologues, gardent pour le moment leur dénomination.